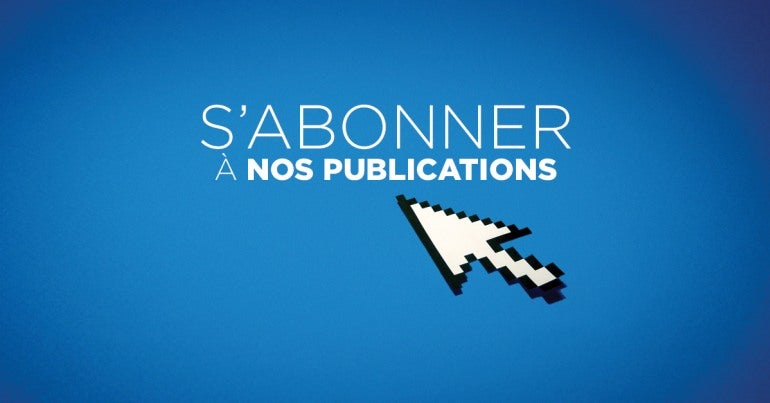Pierre Ducasse | Employé du SCFP
Troy Winters | Employé du SCFP
Chaque 28 avril, à l’échelle du Canada, nous observons le Jour de deuil des travailleuses et travailleurs en l’honneur des personnes tuées ou blessées au travail. Ce qu’il faut savoir est que le SCFP a joué un rôle déterminant dans la création de cette journée.
En 1983, le directeur de la santé et de la sécurité du SCFP, Colin Lambert, a l’idée d’une journée pour reconnaitre les personnes blessées ou tuées au travail. Cet ancien métallo et mineur de Sudbury en fait la suggestion au Comité de santé et de sécurité du SCFP, qui se range derrière cette idée sans tarder.
Au Congrès national du SCFP de 1985, les congressistes adoptent une résolution pour une journée de reconnaissance annuelle pour les personnes qui sont décédées ou ont subi un handicap à cause de leur travail. Un an plus tard, c’est au tour du Congrès du travail du Canada d’endosser l’idée.
Les travailleuses et travailleurs se mobilisent et intensifient ensuite la pression sur les gouvernements pour qu’ils reconnaissent le jour de deuil. En 1991, la Chambre des communes adopte enfin un projet de loi privé, appuyé par le NPD, faisant du 28 avril le « Jour de deuil pour les personnes tuées ou blessées au travail ».
Aujourd’hui, cette journée d’action et de commémoration, dont le canari jaune est le symbole distinctif, est largement observée dans l’ensemble du mouvement syndical canadien et international.
Voici quelques autres faits saillants de notre histoire en matière de santé et de sécurité au travail :
1988
Le Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) est créé en 1988, grâce aux efforts du SCFP et d’autres organisations syndicales. Les employeurs doivent s’assurer que tous les produits chimiques contrôlés sont étiquetés et dotés d’une fiche de données de sécurité sur les lieux de travail avant la date limite.
« Ce système est destiné à protéger les travailleurs et travailleuses de tout le Canada en les renseignant sur les substances dangereuses qu’ils manipulent au travail. Il représente un grand pas en avant », explique Colin Lambert, directeur de la santé et de la sécurité du SCFP, en 1988.
1993
La Saskatchewan devient la première province canadienne à adopter des mesures de protection contre la violence au travail, sous la pression des membres du SCFP-Saskatchewan qui ont organisé un envoi de cartes postales et réalisé des gains historiques à la table de négociation du secteur de la santé.
Pearl Blommaert, membre du SCFP 4980, a joué un rôle prépondérant dans cette bataille pour l’amélioration des normes de santé et de sécurité en Saskatchewan. D’ailleurs, grâce à son travail, elle devient la première femme à recevoir le Prix national de santé et de sécurité, en 2015. Elle a exercé une influence décisive sur les dispositions de santé et de sécurité dans la loi et la réglementation provinciales, ainsi qu’à la création de politiques concernant la prévention des lésions musculo-squelettiques, le travail en solo, les rotations de quarts de travail et le harcèlement psychologique, une autre percée en ce qui a trait aux lois canadiennes de santé et de sécurité.
2004
Le 9 mai 1992, la présence de méthane et de poussière de charbon provoque des explosions au cœur de la mine de charbon Westray à Plymouth, en Nouvelle-Écosse, faisant 26 victimes. La mine n’est alors en activité que depuis huit mois. Dans le cadre de l’enquête publique sur la tragédie de la mine Westray, le SCFP dépose un mémoire dans lequel il dénonce une culture d’intimidation des personnes qui signalent les problèmes et qui favorise le profit avant la sécurité. Plus de 10 ans après, et malgré les efforts des familles, personne n’a été reconnu responsable de la mort de ces mineurs.
Il y a une culture du « ne rien voir, ne rien entendre » entourant le désastre, précise le mémoire présenté par le SCFP à la Commission d’enquête publique sur la mine Westray, en 1996. « Vous devez parler du mal qui a permis encore une fois qu’un nouveau désastre se produise. »
Cette tragédie a marqué la santé et la sécurité au travail en Nouvelle-Écosse et, le 31 mars 2004, le gouvernement du Canada adopte le projet de loi C-45qui modifie l’article 217.1 du Code criminel du Canada. La « loi Westray », comme on l’appelle, ajoute des obligations en matière de santé et de sécurité au travail, en plus de rendre responsables et passibles d’accusations criminelles les organisations où surviennent des accidents de travail et des décès en raison de violations aux règles de santé et de sécurité.
2015
Parution du tout premier sondage canadien sur la violence conjugale et ses impacts au travail, réalisé par le Congrès du travail du Canada et l’Université Western, en collaboration avec le SCFP et d’autres syndicats. On y apprend que plus du tiers des travailleuses et travailleurs ont subi de la violence conjugale au cours de leur vie. Plus de 80 % de ce nombre affirment que la violence conjugale a nui à leur performance au travail, au point parfois de perdre leur emploi. Plus de la moitié des actes de violence se seraient produits au travail ou près du lieu de travail. Plus du tiers des répondant(e)s indiquent que leurs collègues en sont aussi affecté(e)s.
La plupart des gens qui ont répondu au sondage occupent un emploi stable et syndiqué. Cependant, les répercussions négatives au travail sont plus importantes pour les personnes non syndiquées.
En novembre, reconnu comme le Mois de la prévention de la violence conjugale, le Manitoba devient la première province à déposer un projet de loi proposant un congé payé pour les victimes de violence conjugale. Celui-ci est enchâssé dans la loi en 2016 et prévoit à toutes les 52 semaines un congé de 10 jours dont cinq sont payés.
Pour savoir comment chaque section locale peut négocier des protections en lien avec la violence conjugale, consultez le guide de négociation du SCFP intitulé La violence conjugale dans le milieu de travail.
2018
Après des décennies de lobbyisme mené par le SCFP et d’autres syndicats, le 17 octobre 2018, le gouvernement fédéral interdit la production et l’installation de la plupart des produits à base d’amiante et de produits dérivés.
Le SCFP décriait depuis longtemps le danger que représente l’amiante dans les édifices publics pour la vie des travailleuses et travailleurs qui les construisent, les entretiennent et y travaillent, pendant que le gouvernement et l’industrie se démenaient pour garder les mines d’amiante ouvertes.
« Cette interdiction est un pas dans la bonne direction », déclare le président national du SCFP, Mark Hancock, en célébrant cette grande victoire du mouvement syndical. « Le gouvernement fédéral doit maintenant travailler avec les provinces pour harmoniser les réglementations et mettre en place des stratégies pour traiter les maladies causées par l’exposition à l’amiante. »
Pour un SCFP plus sécuritaire et plus inclusif
En mars 2021, le Conseil exécutif national (CEN) du SCFP mettait sur pied le Groupe de travail national pour un milieu syndical sécuritaire. Ce groupe, composé des femmes membres du CEN, a mené des sondages auprès des membres, en plus d’organiser des groupes de discussion et des sessions d’écoute. Il a découvert que de nombreux membres du SCFP, particulièrement les femmes et les membres de groupes d’équité, ne participent pas pleinement au syndicat, faute de se sentir en sécurité.
Après avoir recueilli des informations auprès des membres, le Groupe de travail a collaboré avec des spécialistes pour déterminer les prochaines étapes de sa démarche. Puis, en avril 2022, il a présenté ses recommandations dans un rapport d’étape et un plan d’action. Le groupe de travail a présenté son rapport final à notre Congrès national d’octobre 2023. Depuis, le SCFP met ces recommandations en pratique. Cliquez ici pour en savoir plus!