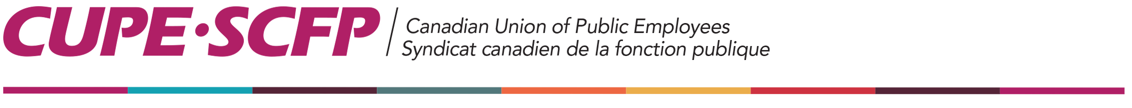Dans le cadre de l’engagement du SCFP de tirer profit des expériences des personnes autochtones, noires et racisées, et de célébrer leurs réussites, nous vous présentons des membres du Comité national pour la justice raciale et du Conseil national des Autochtones. L’article de ce mois-ci présente Debra Mason, membre du Comité national pour la justice raciale.
Dans le cadre de l’engagement du SCFP de tirer profit des expériences des personnes autochtones, noires et racisées, et de célébrer leurs réussites, nous vous présentons des membres du Comité national pour la justice raciale et du Conseil national des Autochtones. L’article de ce mois-ci présente Debra Mason, membre du Comité national pour la justice raciale.
Depuis ses débuts dans le militantisme populaire pour appuyer les personnes noires et racisées jusqu’à son implication dans son comité de négociation, Debra Mason a toujours aidé les travailleuses et travailleurs à défendre leurs revendications et à lutter pour leurs droits.
Debra, éducatrice à la petite enfance depuis 20 ans, travaille actuellement à la clinique Mount Carmel, à Winnipeg. Membre du SCFP 204, elle s’implique activement dans sa section locale depuis environ 12 ans et sert son quatrième mandat au Comité national pour la justice raciale, dont le second à titre de coprésidente.
Du milieu communautaire au milieu syndical
Née au Royaume-Uni de parents originaires de la Jamaïque et de Trinité-et-Tobago, Debra habite au Canada depuis l’âge de 10 ans. Elle a fait ses débuts comme militante communautaire au sein du Workers of Colour Support Network, à Winnipeg.
« On travaillait avec des personnes aux prises avec des difficultés au travail, qui subissaient de la discrimination ou qui avaient été renvoyées pour diverses raisons, et qui avaient besoin que l’on se batte pour elles », se souvient-elle.
« Beaucoup de personnes racisées n’occupent pas les meilleurs emplois ou vivent de mauvaises expériences au travail. À mes débuts, j’ai eu du mal à trouver du travail à temps plein. C’était toujours à temps partiel ou occasionnel, jamais un emploi à temps plein avec des avantages sociaux et une pension », explique-t-elle.
« Lorsqu’on a de la difficulté à trouver du travail, notre estime personnelle diminue beaucoup, dit Debra. Le Workers of Colour Support Network et son dirigeant, Louis Ifill, m’ont appris qu’on est plus que notre travail. Qu’on vaut bien plus que ce qu’on fait. Que notre valeur réside dans notre humanité. »
Debra a été inspirée par son implication au sein du Workers of Colour Support Network. « J’ai vu la force qu’il fallait pour lutter, pour dire ʺnon, je n’accepte pas celaʺ et pour se défendre. Ce n’est pas facile. C’est très exigeant. »
Lors d’une réunion de sa section locale, on lui a proposé de présenter sa candidature au Comité national arc-en-ciel, ancien nom du Comité national pour la justice raciale. Hésitante, elle a attendu le dernier jour pour le faire.
Son implication syndicale s’est accrue lors de sa nomination pour représenter le Manitoba, un rôle national qui l’a menée à travailler davantage sur le terrain. « Siéger au Comité m’a rendue plus active dans ma section locale », affirme-t-elle.
Tenir bon pendant les négociations
En 2017, à la suite de la restructuration du secteur de la santé imposée par le gouvernement qui a entraîné des votes de représentation dans la province, la section locale de Debra a fusionné avec une douzaine d’autres pour former le SCFP 204.
Lorsque le gouvernement provincial a menacé de séparer les travailleuses et travailleurs en éducation à la petite enfance et le personnel de la santé, Debra a aidé à la mobilisation pour empêcher cette division. « On a une meilleure pension et un meilleur salaire que les autres travailleuses et travailleurs en éducation à la petite enfance », précise-t-elle.
La clinique où travaille Debra dispose de sa propre convention collective. Debra s’est jointe au comité de négociation au moment d’établir le premier contrat de la section locale. Ce fut une ronde de négociations intense qui a mené les membres à deux doigts d’une grève.
L’employeur proposait des compressions au congé de maternité, un régime de retraite à deux niveaux et d’autres concessions. « C’était horrible. Je pense que l’employeur voulait qu’on perde notre accréditation, explique Debra. Ce qui est bien avec le SCFP, c’est qu’on ne recule pas. On ne fait pas de concessions, on va de l’avant. Alors, on a défendu nos revendications. »
La difficulté des négociations n’est pas venue à bout de la détermination des membres. « Beaucoup d’entre nous sont des femmes racisées, et elles m’ont impressionnée. Elles ont rejeté le statu quo », se souvient-elle.
En plus de repousser les concessions, les membres ont obtenu des gains sur le plan salarial. Toutefois, selon Debra, le travail du personnel en éducation à la petite enfance demeure sous-estimé et sous-payé.
À pied d’œuvre pendant la pandémie
Debra a travaillé pendant la pandémie de la COVID-19. Elle a pris soin d’enfants qui suivaient leurs cours en ligne pendant que leurs parents offraient des services de première ligne. Au début, ni elle ni les autres personnes n’avaient d’information sur le virus ni d’équipement de protection individuelle. « Le vaccin n’était pas encore disponible, alors c’était très effrayant », explique-t-elle.
Au début de la pandémie, le Comité national pour la justice raciale a tenu des réunions virtuelles mensuelles pour permettre aux membres de se soutenir. Pour Debra, ces réunions ont été une véritable bénédiction, car elles l’ont aidée à gérer le traumatisme et le deuil vécus au cours de cette période.
« Il y a tellement de personnes décédées dont on ne parle pas – tous ces travailleuses et travailleurs de première ligne qui ont perdu la vie. Beaucoup me ressemblaient. Ces personnes sont mortes parce qu’elles étaient aux premières lignes, mais leur travail n’était pas reconnu. »
Debra estime qu’elle joue un rôle important auprès des enfants dont elle s’occupe en tant qu’éducatrice à la petite enfance. Le centre où elle travaille sert diverses communautés, notamment des mères qui consomment des substances, des personnes nouvellement arrivées au Canada et des familles dans le besoin.
Elle a travaillé auprès de nourrissons, mais travaille maintenant auprès d’enfants d’âge préscolaire. « C’est plus exigeant. Les enfants te répondent, ce que je ne déteste pas », affirme-t-elle en riant.
Prendre du recul et partager le pouvoir
Debra est heureuse d’avoir contribué à élaborer la Stratégie du SCFP de lutte contre le racisme. « On l’attendait depuis longtemps, et elle était nécessaire, dit-elle. La main-d’œuvre change, la population change. »
Selon Debra, il est essentiel d’intégrer les expériences des membres autochtones, noir(e)s et racisé(e)s à l’ensemble du travail du SCFP, notamment devant l’essor de l’intelligence artificielle.
« Combien d’emplois seront perdus? Qui seront les premières personnes à perdre leur emploi? Je pense que ce seront les personnes qui me ressemblent. On était les dernières arrivées, on sera les premières à partir. »
Il est tout aussi important d’éliminer les obstacles qui nuisent à la participation syndicale des membres autochtones, noir(e)s et racisé(e)s. « Certaines personnes ont l’impression qu’elles ne sont pas les bienvenues, que personne ne fait appel à elles. C’est un combat, mais je suis contente des efforts du SCFP pour accroître leur participation. C’est un début, et ça se poursuivra. »
Debra a rencontré divers obstacles, notamment lorsqu’elle a voulu faire du bénévolat et que personne ne donnait suite à ses offres. « Je crois que les gens du syndicat ont parfois du mal à voir au-delà de leur poste et des personnes qui les entourent. C’est peut-être simplement la nature humaine. On va vers les personnes avec qui on est le plus à l’aise. »
Elle voit le changement qui s’opère autour d’elle. À son avis, pour rendre le syndicat accessible à plus de membres autochtones, noir(e)s et racisé(e)s, il faut prendre du recul et partager le pouvoir.
« Il s’agit de sortir de sa zone de confort et de faire une place aux autres, d’avoir confiance en soi pour savoir que tout se passera bien. C’est correct de prendre du recul et de laisser du pouvoir aux autres, de les conseiller. C’est une bonne chose. L’objectif, c’est d’avancer », explique-t-elle.
Debra encourage les membres autochtones, noir(e)s et racisé(e)s à s’impliquer dans leur syndicat. « Ce ne sera peut-être pas très plaisant, mais ne lâchez pas. Continuez vos démarches et amenez d’autres personnes avec vous. Faire partie de ce comité m’a aidée parce que j’étais bien entourée. Je savais que je n’étais pas seule. J’avais des gens avec qui parler. »
Pour en savoir davantage sur la Stratégie du SCFP de lutte contre le racisme, notamment sur l’objectif 4 — Apprendre de l’expérience des membres noirs, autochtones et racisés et célébrer leurs réussites —, rendez-vous au scfp.ca/stratégie_contre_le_racisme. Voyez également les conseils pour mettre en œuvre la Stratégie dans votre section locale.