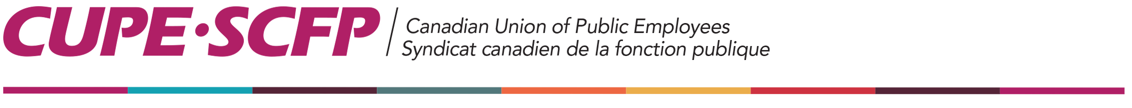SURVOL
Le SCFP représente un peu plus de 73 000 membres dans plus de 230 unités de négociation dans le secteur de l’éducation postsecondaire. Ces membres travaillent dans les universités, les collèges et les associations étudiantes.
Les postes occupés sont très variés. Le SCFP représente autant le personnel de soutien — qui s’occupe de l’entretien des terrains et bâtiments, des bibliothèques, des services alimentaires, de l’informatique, du travail de bureau et de l’administration — que le personnel enseignant — incluant les chargé(e)s de cours, chercheuses et chercheurs, auxiliaires d’enseignement et technicien(ne)s de laboratoire.
L’éducation postsecondaire a connu de grandes turbulences ces dernières années. La pandémie de COVID-19, l’austérité continue et les conséquences des restrictions à l’immigration sur les étudiant(e)s internationaux ont profondément bouleversé le travail et la vie des membres.
Selon le plus récent recensement, plus de 460 000 personnes travaillent dans les universités, les collèges, les instituts de formation professionnelle et les écoles de métiers au Canada. Le SCFP occupe une grande place dans les universités, où il représente le personnel non professoral. Il compte globalement beaucoup moins de membres du côté des collèges, mais en représente quand même un bon nombre en Colombie-Britannique et au Québec.
ENJEUX
Financement
Les études ont établi sans équivoque qu’investir dans l’éducation postsecondaire contribue au bien-être socioéconomique du pays. Alors que le Canada se prépare à absorber le choc de la guerre commerciale avec les États-Unis, les établissements d’enseignement postsecondaire constituent un pilier économique pour plusieurs communautés : ils fournissent des emplois syndiqués, bien payés et stables dans une vaste gamme de professions. Nous avons absolument besoin d’un système postsecondaire solide pour reconvertir et recycler les travailleuses et travailleurs dont les emplois pourraient être touchés par les droits de douane et d’autres perturbations économiques, et pour soutenir la recherche et le développement qui préserveront la prospérité et la souveraineté économiques du Canada dans un monde en rapide évolution.
Malgré ces réalités, les gouvernements fédéral et provinciaux s’entêtent à sous-financer l’éducation postsecondaire. En 1982, 83 % des revenus de fonctionnement des universités provenaient du financement combiné des gouvernements fédéral et provincial. Les imposantes compressions budgétaires du fédéral, ajoutées à celles des provinces, ont fait descendre cette part sous la barre des 50 %. La situation est particulièrement grave en Colombie-Britannique et en Ontario, où les établissements dépendent de manière disproportionnée des droits de scolarité. L’Ontario, même si elle est la province la plus peuplée, accorde le plus faible financement par étudiant(e) au pays.
Au Québec, le financement des universités provient du gouvernement provincial (49,9 %), du gouvernement fédéral (20,9 %), des étudiant(e)s (16,4 %) et d’autres sources (12,9 %). Dans le cadre du Plan d’action pour la réussite en enseignement supérieur 2021-2026, le gouvernement du Québec injecte 450 millions de dollars supplémentaires sur cinq ans.
Toutefois, la plupart des provinces, plutôt que d’investir dans l’avenir, se cantonnent dans l’austérité. En Alberta, l’examen de l’enseignement postsecondaire mené par le gouvernement du Parti conservateur laisse présager des coupes sévères pour les établissements du secteur, imposées par décret du ministère. De la même façon, la loi 12 de la Nouvelle-Écosse met en péril la stabilité du financement public et le droit à la négociation collective en accordant au ministre responsable de l’enseignement postsecondaire un vaste pouvoir pour forcer des restructurations. À Terre-Neuve-et-Labrador, l’Accord sur l’éducation du gouvernement, calqué sur l’Accord sur la santé, risque de se traduire par de grandes compressions sur le budget de l’Université Memorial, en plus de paver la voie à la privatisation.
Lorsque les gouvernements sous-financent l’enseignement postsecondaire, on observe invariablement une hausse des frais de scolarité, une augmentation du recours aux dons et aux contrats privés, et une précarisation des emplois. Les gouvernements aident souvent directement les étudiant(e)s à payer leurs frais de scolarité en leur offrant des subventions, des prêts, des bourses et des crédits d’impôt, mais une grande partie de ce financement est mal ciblé ou versé plus tard, ce qui oblige les étudiant(e)s à payer immédiatement, puis à attendre un crédit d’impôt ou une remise de prêt qui ne viendra que dans un an, voire plus.
La hausse des frais de scolarité a durement frappé les étudiant(e)s internationaux, à qui on peut facturer beaucoup plus qu’aux étudiant(e)s canadien(ne)s, et qui souvent ne sont pas admissibles au soutien financier direct. Résultat : les établissements comptent sur les étudiant(e)s internationaux pour compenser la réduction du financement public, un modèle de financement qui frise l’exploitation. En 2024, le gouvernement fédéral a drastiquement réduit le nombre de visas délivrés aux étudiant(s) internationaux, ce qui a accentué la crise du sous-financement.
Ces attaques répétées ont effrité la stabilité du financement, plongeant plusieurs des systèmes publics d’enseignement postsecondaire du pays dans une spirale infernale. Des établissements éliminent des programmes, d’autres ferment des campus entiers. Si le personnel de ces établissements en subirait les premiers contrecoups, les effets se feront plus largement sentir sur l’économie de même que sur les perspectives économiques des étudiant(e)s et des communautés un peu partout au pays.
Privatisation, influence des grandes sociétés et changements technologiques
Le déclin du financement public a aussi transformé le mode de gouvernance et de fonctionnement des établissements d’enseignement postsecondaire. Plus ceux-ci acceptent les dons d’entreprise, signent des contrats assortis de conditions, confient leur gestion et leur administration à des dirigeant(e)s d’entreprises qui cherchent à réduire les coûts pour maximiser les profits, plus s’érode leur mission d’offrir un enseignement public de qualité. Les établissements se tournent aussi vers la financiarisation; l’investissement et la spéculation immobilière composent actuellement la portion des recettes universitaires qui croît le plus rapidement.
La privatisation et la sous-traitance des services sont deux autres tactiques prisées par les administrations de plus en plus sous l’influence des grandes sociétés. Le rapport du SCFP intitulé Qui paie? Le coût de la sous-traitance dans les établissements postsecondaires canadiens relève que 83,7 % des établissements ont confié en sous-traitance une partie ou la totalité de leurs services d’alimentation, tandis que 61 % l’ont fait pour une partie ou la totalité des services d’entretien (et la moitié ont sous-traité les deux). Or, la sous-traitance a de graves répercussions sur les travailleuses et travailleurs. Le rapport souligne que cette méthode prive les travailleuses et travailleurs de plus de 1 000 dollars par mois en salaire, sans parler de la détérioration de leurs avantages sociaux comme les régimes de retraite et les congés de maladie.
Le personnel contractuel est aussi plus vulnérable aux attaques contre son syndicat à la suite d’un transfert de contrat. Au Nouveau-Brunswick, les sections locales qui représentent le personnel d’entretien et des services alimentaires ont perdu leur accréditation syndicale à la suite d’un transfert de contrat, accréditation qu’elles n’ont regagnée qu’après un long combat. De nombreuses sections locales du SCFP luttent contre la sous-traitance des services fournis par leurs membres. En Ontario, le SCFP a réussi à ramener à l’interne des services universitaires qui étaient sous-traités, notamment l’aide aux études, les services alimentaires, le nettoyage et la maintenance.
Les administrations des établissements postsecondaires se servent de plus en plus des nouvelles technologies pour sous-traiter le travail. L’automatisation et l’intelligence artificielle (IA) ont été utilisées pour remplacer le personnel d’entretien des terrains et bâtiments par des robots, et de plus en plus de tâches liées à l’enseignement (comme la correction et la notation) sont exécutées par des programmes d’IA. La plupart de ces technologies sont contrôlées par des sociétés à but lucratif, dont plusieurs sont basées aux États-Unis, et dont les services sont retenus par les administrations des établissements. Des membres du personnel des établissements publics risquent de perdre leur emploi ou de devoir travailler plus fort si ces technologies du privé engendrent de nouvelles pressions et accroissent leurs responsabilités. Le SCFP a rédigé un Guide de négociation sur l’IA pour aider les sections locales dans leurs négociations sur des questions comme la numérisation et l’IA.
En plus d’assister à la dégradation et à la corporatisation des établissements postsecondaires publics, on voit maintenant l’industrie des collèges à but lucratif se développer rapidement, avec le soutien des gouvernements provinciaux de droite. Dans plusieurs provinces, des collèges privés à but lucratif offrent des cours qui peuvent ensuite être crédités dans un programme d’une université publique. D’autres ont également signé des accords leur permettant de délivrer un diplôme au nom d’un collège recevant du financement public.
Santé et sécurité
De nombreux campus se sont empressés de rouvrir pendant la pandémie. En Ontario, les universités ont rouvert leurs portes sans consulter les syndicats. La préparation aux éventuelles pandémies demeure déficiente dans les établissements postsecondaires, et le recours croissant à des partenariats public-privé (PPP) pour gérer les installations (y compris le logement étudiant) mine la capacité des administrations universitaires à prévenir les éclosions de maladies infectieuses.
L’arriéré d’entretien différé sur les campus continue de croître; on l’estimait déjà à 17,9 milliards de dollars en 2019. Cela signifie que les étudiant(e)s et le personnel apprennent et travaillent dans des installations qui se détériorent, ne satisfont plus aux normes et font courir des risques variés (p. ex. glissades et chutes, exposition à des produits chimiques dangereux, faible éclairage). Le cadre de financement des établissements d’enseignement postsecondaire encourage les administrations à investir dans de nouveaux bâtiments et autres immobilisations, par exemple de nouvelles machines, plutôt qu’à réparer, rénover et moderniser les installations existantes. La vague d’austérité continuant de déferler, la détérioration des campus et des installations ne peut que s’intensifier.
Violence et harcèlement sexuels
Tout le monde a le droit de travailler, de vivre et d’apprendre dans un milieu sûr. La violence et le harcèlement sexuels sont des questions graves qui concernent l’ensemble des membres du milieu de travail, du syndicat et de la communauté collégiale ou universitaire.
Le SCFP s’est engagé à combattre et à prévenir la violence sexuelle au travail. Il existe à cet égard des facteurs spécifiques aux établissements postsecondaires qui doivent être pris en considération. Le SCFP a préparé des outils sur la violence et le harcèlement sexuels dans l’éducation postsecondaire afin d’aider les comités exécutifs des sections locales, les personnes déléguées et les membres à combattre et à prévenir ces problèmes dans le secteur. Nous nous appliquons à développer une culture du consentement sur les campus, une approche plus efficace que les seules mesures punitives.
NÉGOCIATION
Salaires et avantages sociaux
La diminution du financement gouvernemental a également des répercussions importantes sur les salaires, les avantages sociaux et les conditions de travail, et ce, pour les membres du SCFP également. La précarité d’emploi, la sous-traitance, la privatisation et l’influence des grandes sociétés gagnent en importance dans les établissements postsecondaires. Le SCFP continue à vivre des rondes de négociations difficiles en raison du sous-financement dans le secteur.
En 2023-2024, d’importants règlements salariaux, tenant compte de la forte hausse du taux d’inflation depuis la pandémie, ont été négociés dans le secteur. Ces règlements, souvent obtenus au prix de grands efforts, sont le reflet de la hausse du militantisme syndical observée au Canada. Dans plusieurs cas, les unités du SCFP ont obtenu leurs gains grâce à des stratégies de négociations concertées. À l’Université Queen’s à Kingston, en Ontario, les sections locales du SCFP ont joué un rôle primordial au sein du Unity Council, qui coordonnait la négociation pour tous les syndicats du campus. Les multiples unités de négociation des sections locales 3902 et 3261 de l’Université de Toronto ont coordonné leurs démarches pour obtenir des gains financiers appréciables.
Tout en refusant de s’engager à financer adéquatement le secteur, les gouvernements provinciaux s’ingèrent régulièrement dans les négociations collectives en fixant certains salaires. Même si la loi 124 de l’Ontario restreignant les salaires dans tout le secteur public a été abrogée, les gouvernements, notamment de l’Alberta et de la Colombie-Britannique, continuent leurs manœuvres pour fixer les salaires en amont des négociations collectives. La loi 12 en Nouvelle-Écosse et le projet de loi 33 en Ontario dénotent également une tendance inquiétante à recourir à la législation pour réduire l’autonomie des établissements postsecondaires et contourner les négociations collectives libres et équitables.
Précarité d’emploi
La diminution du financement gouvernemental et l’influence croissante du milieu des affaires au sein des administrations collégiales et universitaires contribuent à accroître le nombre d’emplois précaires dans le secteur. Selon une étude effectuée par le SCFP, 54 % des nominations professorales dans les universités canadiennes sont contractuelles plutôt que permanentes. Les postes à temps partiel, occasionnels et temporaires ont aussi augmenté dans les rôles de soutien. La sous-traitance aggrave aussi la précarité. Dans certains cas, les collèges et universités ont recours à l’attrition pour contourner les articles de convention collective empêchant les licenciements, afin de remplacer les postes permanents par des postes occasionnels et temporaires.
Les changements du fédéral concernant les visas pour étudiant(e)s internationaux et les programmes connexes sont venus souligner les effets néfastes de la précarité d’emploi. Les employeurs du secteur ont en effet compensé la perte des droits de scolarité venant de la communauté étudiante internationale en annulant ou en ne renouvelant pas des contrats d’enseignement, une manœuvre qui a permis de contourner les droits des personnes mises à pied. À l’Université Carleton à Ottawa, en Ontario, la coupe de postes de chargé(e)s de cours contractuels a éliminé la moitié du personnel enseignant, tandis qu’à l’Université Saint Mary’s en Nouvelle-Écosse, le personnel spécialisé en enseignement des langues et le personnel auxiliaire ont vu leur poste remplacé par le recours à l’IA et aux robots d’apprentissage linguistique.
Syndicalisation
Voici quelques récentes campagnes de syndicalisation réussies dans le secteur de l’enseignement postsecondaire :
- Auxiliaires universitaires aux cycles supérieurs à l’Université de la Colombie-Britannique (2023)
- Personnel de soutien à l’Université du Québec à Montréal et à l’Université du Québec à Chicoutimi (2023)
- Auxiliaires d’enseignement à l’Université Saint Mary’s et au Collège d’art et de design de la Nouvelle-Écosse (2023)
- Personnel de soutien à l’Agence universitaire de la francophonie (2023)
- Chargé(e)s de cours à temps partiel et auxiliaires d’enseignement à l’Université de Waterloo (2024)
- Chargé(e)s de cours en infirmerie clinique (2023) et en enseignement (2025) à l’Université Brock
- Personnel d’entretien à l’École des hautes études commerciales de Montréal (HEC) (2024)
- Personnel de l’Observatoire canadien sur l’itinérance à l’Université York (2024)
Les auxiliaires de recherche aux cycles supérieurs de l’Université de la Colombie-Britannique se sont aussi syndiqué(e)s en 2024, mais l’employeur a entamé des poursuites judiciaires pour que leur accréditation soit retirée, sous le prétexte erroné que les étudiant(e)s en recherche ne sont pas des travailleuses ou travailleurs. Le SCFP se bat pour le droit des travailleuses et travailleurs étudiant(e)s à se syndiquer et à négocier collectivement pour améliorer leurs conditions d’emploi à l’Université de la Colombie-Britannique comme ailleurs au pays.
Régimes de retraite
Dans les universités, la plupart des régimes de retraite sont offerts par l’employeur. Au collégial, la plupart des régimes regroupent plusieurs employeurs et sont régis par la législation provinciale. Le plus souvent, ces régimes de retraite sont à prestations déterminées. Depuis la récession de 2008, les employeurs attaquent ces régimes et cherchent à en réduire les prestations ou à transférer les risques au personnel, notamment en transformant les régimes à prestations déterminées en régimes à cotisations déterminées ou à prestations cibles.
Trois universités ontariennes (Guelph, Toronto et Queen’s) ont mis sur pied l’University Pension Plan (UPP), un régime de retraite multi-employeurs financé conjointement. Le personnel du SCFP et les comités exécutifs des sections locales se sont assurés que ce nouveau régime protégera la sécurité financière des membres à la retraite. Alors que de plus en plus d’universités réexaminent leurs régimes de retraite, plusieurs autres sections locales du SCFP pourraient se retrouver à négocier avec leur employeur une adhésion à l’UPP. Le SCFP travaillera avec elles pour qu’elles aient une voix forte dans ces pourparlers.
À Terre-Neuve, l’Université Memorial s’apprête à mettre en place un modèle de gestion et de financement conjoints pour son régime de retraite.