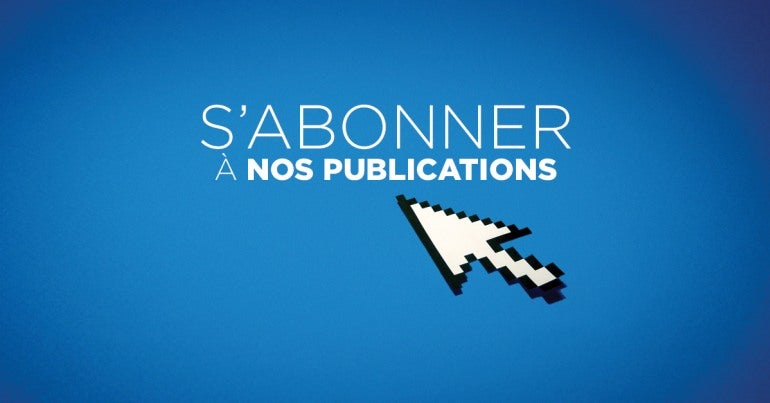En janvier 2024, le gouvernement fédéral a apporté plusieurs changements importants à l’attribution et à la gestion des visas pour les étudiant(e)s internationaux et aux programmes d’immigration connexes. Ces changements, que le gouvernement justifie par la nécessité de réduire la pression sur le logement, le système de santé et d’autres services, ont abaissé d’environ 40 % le nombre d’étudiant(e)s internationaux admis au Canada et restreint considérablement le nombre de permis de travail temporaires.
Depuis, une crise frappe le secteur universitaire et collégial. Les établissements réduisent leurs programmes et leurs effectifs. L’économie s’en ressent, tout comme le marché de l’emploi un peu partout au pays. Bien souvent, les étudiant(e)s internationaux continuent de travailler dans la communauté après leurs études, par l’entremise du programme de permis de travail postdiplôme ou du Programme des candidats des provinces.
Les répercussions économiques de ces changements toucheront plus durement les petites communautés rurales que les grands centres urbains. Les petites communautés rurales tendent à dépendre davantage de l’immigration que les centres urbains pour répondre à leurs besoins en main-d’œuvre, particulièrement dans le secteur des soins puisque le vieillissement de la population est plus important en milieu rural.
Les petites agglomérations et les communautés rurales comptent également davantage sur les établissements postsecondaires comme pilier de leur économie. Au-delà des emplois créés directement par les campus, les dépenses effectuées localement par les étudiant(e)s et le personnel soutiennent les petites entreprises, le marché locatif et d’autres services; les activités sportives et artistiques alimentent la fierté locale; et il y a souvent des occasions de partenariat entre les industries locales et les équipes de recherche. Plutôt que de drainer les ressources locales, les étudiant(e)s internationaux représentent un avantage financier pour les gouvernements, les établissements d’enseignement supérieur et les communautés où ils et elles vivent et travaillent.
Avant 1992, 80 % du financement des établissements d’enseignement supérieur provenait des gouvernements fédéral et provinciaux, mais en 2024-2025, ce ratio est passé sous la barre des 50 %. Pour combler le manque de financement, les universités et les collèges n’ont cessé d’augmenter les frais de scolarité pour les étudiant(e)s internationaux et se font concurrence pour en attirer le plus grand nombre. En 2006-2007, les frais de scolarité moyens pour un(e) étudiant(e) international(e) pour un diplôme de premier cycle étaient trois fois plus élevés que ceux d’un(e) étudiant(e) canadien(ne). En 2024-2025, ils étaient de cinq fois et demie supérieurs.
L’immigration temporaire, qui inclut les travailleuses et travailleurs migrants et les étudiant(e)s internationaux, est cruciale pour soutenir l’économie canadienne dans de multiples secteurs. Elle permet de :
1. Combler les besoins en main-d’œuvre
- Les travailleuses et travailleurs migrants, notamment celles et ceux qui viennent dans le cadre du Programme des travailleurs étrangers temporaires et du Programme des travailleurs agricoles saisonniers, jouent un rôle essentiel dans des secteurs comme :
- l’agriculture, pour la récolte des cultures et l’entretien des fermes;
- la construction, l’hôtellerie, la santé et l’industrie manufacturière.
- Il s’agit souvent d’emplois mal rémunérés, touchés par une pénurie de main-d’œuvre et qui intéressent peu les résident(e)s canadien(ne)s.
- Sans les travailleuses et travailleurs migrants, de nombreuses entreprises seraient en sous-effectif chronique, ce qui aurait un impact sur la productivité et les chaînes d’approvisionnement alimentaire.
2. Soutenir les établissements d’enseignement postsecondaire
- Les étudiant(e)s internationaux injectent chaque année des milliards de dollars à l’économie canadienne par l’entremise :
- des frais de scolarité, qui sont souvent beaucoup plus élevés que pour les étudiant(e)s canadien(ne)s;
- de leurs dépenses courantes, notamment pour le logement, la nourriture et le transport.
- Leur présence soutient de nombreux établissements d’enseignement supérieur, en particulier dans les petites agglomérations et les communautés rurales.
- Les étudiant(e)s internationaux contribuent au financement de la recherche, de l’innovation et du personnel.
3. Augmenter la consommation et renforcer l’économie locale
- Les immigrant(e)s temporaires dépensent de l’argent localement, ce qui soutient les petites entreprises, le secteur du transport et du logement, et d’autres services.
- Cette consommation stimule la demande locale et crée des emplois, en particulier dans les centres urbains où la population augmente en raison de l’immigration.
4. Soutenir les objectifs d’immigration à long terme
- Beaucoup d’immigrant(e)s temporaires obtiennent par la suite leur résidence permanente, ce qui permet de répondre aux défis démographiques et aux exigences du marché du travail à long terme.
- L’immigration fait contrepoids au vieillissement de la population et à la baisse du taux de natalité au Canada, deux préoccupations majeures pour la viabilité de notre économie et le financement de notre système de santé.
5. Accroître les revenus du gouvernement
- Les résident(e)s temporaires paient de l’impôt sur le revenu, des taxes de vente et de l’impôt foncier (souvent par l’entremise du loyer).
- Dans bien des cas cependant, certains services publics ne leur sont pas pleinement accessibles, comme les soins de santé ou l’aide financière pour les études.
- Il en résulte un bénéfice fiscal net pour le gouvernement.
En mettant sur le dos des immigrant(e)s temporaires les problèmes d’infrastructure ou de logement, on ignore les problèmes structurels liés à la planification, au développement et aux politiques publiques. Ces personnes qui viennent travailler et étudier au Canada ne sont pas de simples participant(e)s : elles sont des acteurs clés de la croissance et de la résilience de l’économie canadienne. Une politique efficace doit reconnaître à la fois leurs contributions et la nécessité d’investir dans des infrastructures adaptées à une population croissante et diversifiée.