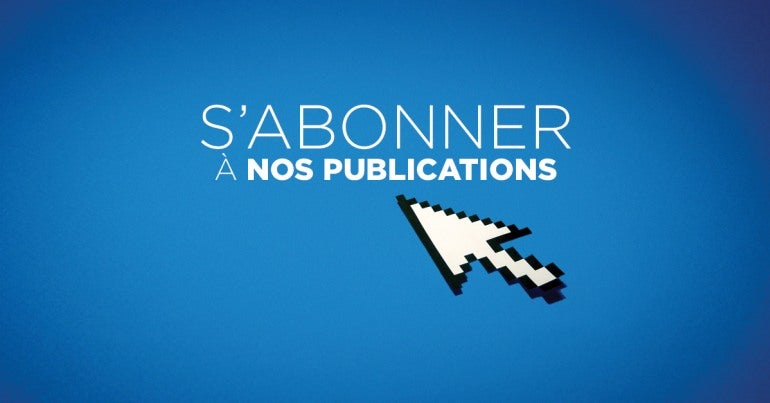Privatisation des interventions chirurgicales : augmentation possible des temps d’attente et des coûts
Privatisation des interventions chirurgicales : augmentation possible des temps d’attente et des coûts
Un nouveau rapport du Centre canadien de politiques alternatives intitulé « At What Cost? Ontario hospital privatisation and the threat to public health care » a révélé que la hausse du recours au secteur privé en santé en Ontario entraînerait probablement une augmentation du temps d’attente pour les chirurgies et des coûts pour le public. Le rapport s’appuie sur des demandes d’accès à l’information, des analyses financières et statistiques, et des recherches à l’échelle internationale pour évaluer les coûts et les avantages du plan du gouvernement ontarien visant à augmenter le recours aux cliniques privées pour les interventions chirurgicales.
Dans le rapport, on indique que le gouvernement de l’Ontario sous-estime grandement les paiements versés aux cliniques privées parce qu’il n’inscrit pas les rémunérations à l’acte comme catégorie de dépenses distincte dans les Comptes publics. On souligne aussi qu’avec l’augmentation des interventions chirurgicales au privé, les salles d’opération dans les hôpitaux publics sont moins utilisées. Cette baisse cadre avec ce qu’on a observé en Alberta à la suite de la privatisation des opérations chirurgicales. Ce genre de dynamique fait augmenter les coûts sans réduire le temps d’attente. Le rapport recommande de prioriser l’utilisation de modèles à entrée unique et axés sur le travail d’équipe, et de maximiser et d’étendre la capacité des salles d’opération publiques pour éliminer les délais d’attente pour les interventions chirurgicales.
Faits sur l’insécurité alimentaire
L’augmentation du prix des aliments de base touche beaucoup de familles. Statistique Canada s’est penché sur la corrélation entre le revenu et l’insécurité alimentaire, laquelle se définit comme « l’incapacité de se procurer ou de consommer des aliments de qualité, ou en quantité suffisante, de façon socialement acceptable, ou encore l’incertitude d’être en mesure de le faire ». L’étude a révélé que la proportion de familles vivant de l’insécurité alimentaire est passée de 16 % en 2021 à 18 % en 2022, et que 8 familles en situation d’insécurité alimentaire sur 10 avaient un revenu supérieur au seuil de pauvreté. La variation de l’insécurité alimentaire sur l’échelle du revenu au-delà du seuil de pauvreté n’a pas été analysée, mais les constats démontrent que l’accès à une quantité suffisante d’aliments sains ne dépend pas que du revenu.
En effet, l’insécurité alimentaire est plus fréquente chez les mères monoparentales, quel que soit leur revenu, et encore plus chez celles qui sont autochtones ou noires. En général, les familles autochtones et racisées sont plus susceptibles de vivre de l’insécurité alimentaire que leurs homologues allochtones ou non racisées. Près de 30 % des familles autochtones et noires ayant un revenu supérieur au seuil de pauvreté ont vécu de l’insécurité alimentaire en 2022. Des 10 provinces, le taux d’insécurité alimentaire le plus bas en 2022 était au Québec (14 %), et le plus élevé, à Terre-Neuve-et-Labrador (23 %).
Impôts et changements climatiques
Un nouveau rapport de l’organisme Canadiens pour une fiscalité équitable, intitulé « L’impôt et la voie vers une économie verte », examine dans quelle mesure les subventions fiscales canadiennes continuent de bénéficier à l’industrie des combustibles fossiles. On y recommande que le gouvernement fédéral fasse plus que promettre d’éliminer les subventions « inefficaces » pour les combustibles fossiles, et qu’il supprime tous les avantages fiscaux qui bénéficient à ce secteur. Le rapport révèle aussi que les riches — entreprises et particuliers — ont profité considérablement de ces subventions alors que la majeure partie des émissions de combustibles fossiles leur était attribuable. Si nous avons toutes et tous une responsabilité financière dans l’adaptation aux changements climatiques et l’atténuation de leurs effets, nous ne pouvons pas laisser celles et ceux qui ont profité du système fuir leurs responsabilités. Les recommandations du rapport aideront à faire avancer la question de la lutte contre les changements climatiques et de l’inégalité économique.