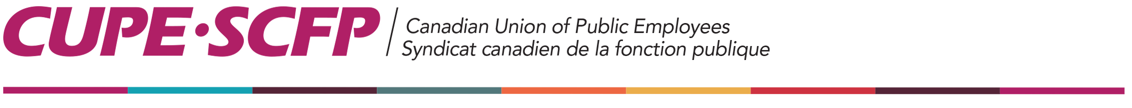SURVOL
Le SCFP représente plus de 225 000 travailleuses et travailleurs de la santé d’un océan à l’autre. De ce nombre, environ 190 000 sont membres d’une section locale qui relève entièrement du secteur de la santé. Ces membres travaillent notamment dans les hôpitaux, les établissements de soins de longue durée, des organismes de santé publique et communautaire, les soins à domicile, à la Société canadienne du sang et à Héma-Québec. Les autres sont membres d’une section locale qui représente le secteur municipal ou des services sociaux.
Le SCFP représente des travailleuses et travailleurs de la santé dans toutes les provinces; ces membres se trouvent principalement en Ontario (Conseil des syndicats d’hôpitaux de l’Ontario, ou CSHO-SCFP), en Colombie-Britannique (Syndicat des employé(e)s d’hôpitaux, ou SEH), au Québec (Conseil provincial des affaires sociales, ou CPAS), au Manitoba, en Saskatchewan et au Nouveau-Brunswick.
La pandémie de COVID-19 a illustré à quel point le réseau et le personnel de la santé sont essentiels pour promouvoir et protéger la santé, la sécurité et l’intérêt du public en général. Partout au pays, les travailleuses et les travailleurs de la santé sont en première ligne des crises sanitaires et mettent leur santé et leur sécurité à risque pour protéger chacun(e) d’entre nous.
ENJEUX
Soins de longue durée
Pendant la pandémie, les soins de longue durée ont fait couler beaucoup d’encre au pays. En effet, 52 % des décès liés à la COVID-19 sont survenus dans des centres de soins de longue durée et des résidences pour personnes âgées, alors que ces établissements n’accueillent que 1,13 % de la population canadienne. Nos gouvernements ont très mal protégé la vie des plus vulnérables contre la COVID-19.
La pandémie n’est toutefois pas à l’origine des problèmes que nous voyons dans le système de soins de longue durée. Elle a plutôt mis en lumière des problèmes qui existaient déjà, et les a aggravés, surtout en ce qui concerne la pénurie chronique de personnel et les horaires de soins inadéquats. Ces dernières années, plusieurs sections locales et divisions du SCFP ont milité pour la hausse du nombre d’heures de soins dans les établissements de soins de longue durée. Après une campagne de plusieurs années menée par le SCFP-Ontario et la Coalition ontarienne de la santé, une nouvelle loi a été adoptée en 2021. Celle-ci portera, d’ici 2025, à quatre heures par jour en moyenne les heures de soins par résident(e) dans les centres de soins de longue durée de l’Ontario.
Santé et sécurité
Tout au long de la pandémie de COVID-19, les travailleuses et travailleurs de la santé du pays, qui ont été salués comme des héros, ont dû faire face à de sérieux défis, notamment :
- le manque d’EPI adéquat;
- un taux d’infection à la COVID-19 élevé;
- la peur de transmettre la COVID-19 à leurs proches;
- le surmenage, le stress, l’épuisement professionnel et les répercussions sur leur santé mentale.
Le SCFP poursuit ses efforts pour protéger la santé et la sécurité des travailleuses et travailleurs de la santé en militant pour que les conventions collectives garantissent l’accès à l’EPI adéquat, et en réclamant la hausse de la fabrication d’EPI au pays et des inventaires suffisants pour faire face aux urgences futures. Le SCFP demande aussi que le principe de précaution soit appliqué lors des urgences de santé publique, c’est-à-dire que les gouvernements et les employeurs prennent toutes les précautions raisonnables pour protéger la santé et la sécurité du personnel, sans nécessairement attendre de certitudes scientifiques. Il est inacceptable que des travailleuses et travailleurs de la santé aient dû porter des sacs à ordures en guise de blouses de protection et des masques périmés et, qu’à certains endroits, des EPI dormaient dans des armoires verrouillées.
Les membres du SCFP ont également mené une campagne de sensibilisation à la violence au travail. En Ontario, le CSHO-SCFP a négocié un nouvel article pour mieux reconnaître et combattre la violence au travail, et obliger les employeurs à suivre une formation sur la désescalade et l’évaluation des risques à l’échelle de leur organisation afin de réduire le nombre d’incidents violents envers le personnel du milieu hospitalier.
Privatisation
Les intérêts privés érodent petit à petit notre système de santé public et la privatisation crée des problèmes dans toutes les sphères du réseau. On n’a qu’à penser à la privatisation des opérations chirurgicales, des soins de longue durée, des soins à domicile, des soins virtuels et de la collecte de plasma… à quoi s’ajoutent la sous-traitance des services de soins directs ou de soutien et le recours croissant aux agences de recrutement. Les partenariats public-privé (PPP) sont aussi présents dans le secteur. Des contrats à long terme pour la construction, le financement, la gestion, l’entretien ou la propriété d’installations publiques, comme des hôpitaux ou des centres de soins de longue durée, sont donc conclus avec le secteur privé.
Les membres du SCFP se battent pour défendre et améliorer les services de santé publics partout au pays. Parmi les récentes victoires, le SEH, la division du SCFP qui représente le personnel de la santé en Colombie-Britannique, a réussi à ramener à l’emploi de l’autorité sanitaire le personnel des services de nettoyage et d’alimentation, après 20 ans de privatisation. Cette victoire est un pas vers l’équité et la justice pour plus de 4 000 travailleuses et travailleurs permanents et occasionnels.
Intelligence artificielle
La montée de l’intelligence artificielle (IA) transforme rapidement le secteur de la santé, suscitant à la fois de nouvelles possibilités et des défis de taille pour nos membres. Bien que l’IA ait le potentiel d’améliorer la prestation de services publics et d’appuyer les travailleuses et travailleurs dans leurs fonctions, elle pose aussi des risques pour la sécurité d’emploi, les droits au travail et le respect de la vie privée des patient(e)s. Il faut gérer prudemment l’intégration de nouvelles technologies afin de s’assurer qu’elles complètent, et non remplacent, le travail essentiel de nos membres. Le SCFP s’engage à faire en sorte que toute utilisation de l’IA dans le secteur de la santé soit transparente et juste, et améliore la qualité des soins et des conditions de travail, sans mener à la perte d’emplois, au renforcement de la surveillance ou à l’érosion des droits de ses membres.
Les membres du SCFP militent pour obtenir des mesures législatives qui les protègent et se servent de la négociation collective pour aborder les risques que présente l’IA. Il s’agit notamment de négocier des clauses qui imposent aux employeurs de mener des études d’impact, obligent la consultation du syndicat, assurent la protection des données et de la vie privée des membres et préviennent l’utilisation de l’IA de manière discriminatoire ou à des fins disciplinaires. Le SCFP continuera de défendre le droit à la vie privée de ses membres et de lutter pour un avenir où la technologie répond aux besoins des travailleuses et travailleurs et de la population, et non aux intérêts privés.
Lourdes charges de travail
Tous les secteurs de la santé connaissent une pénurie de main-d’œuvre qui se traduit par des charges de travail écrasantes et une détérioration de la qualité des soins. Les effectifs dans le secteur de la santé étaient déjà insuffisants en raison de la complexité croissante des conditions médicales des patient(e)s. La pandémie a exacerbé la situation, de nombreux travailleurs et travailleuses ayant quitté le secteur pour trouver des emplois offrant de meilleurs salaires et conditions de travail.
La situation est si grave qu’il manque littéralement d’employé(e)s pour occuper tous les postes vacants dans le domaine de la santé. Le nombre de postes vacants est toujours aussi élevé pour les infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés, les aides, les préposé(e)s aux bénéficiaires, les associé(e)s au service de soins aux patient(e)s et les technologistes médicaux. Ainsi, le personnel de première ligne est toujours ou souvent en sous-effectif, ce qui crée des charges de travail impossibles à gérer et entraîne une augmentation de la violence a son égard. Il reste beaucoup à faire pour rendre le secteur de la santé plus attrayant : notamment améliorer les salaires et les conditions de travail, offrir plus d’emplois à temps plein et accroître les effectifs.
NÉGOCIATION
Types de négociation
Il existe au Canada différentes structures de négociation dans le secteur de la santé. Les personnes syndiquées qui travaillent dans les hôpitaux, les services de soins de longue durée et les soins à domicile négocient ensemble en Colombie-Britannique, en Saskatchewan, au Manitoba et au Québec. Dans plusieurs cas, le secteur public coordonne ses négociations, alors que les fournisseurs privés de soins de longue durée et de soins à domicile négocient séparément. Dans plusieurs provinces, dont la Colombie-Britannique, le Manitoba et la Nouvelle-Écosse, chaque groupe professionnel (services de soutien, infirmières et infirmiers, etc.) a sa propre convention collective.
Les sections locales du SCFP collaborent souvent étroitement avec d’autres syndicats de la santé pour défendre des revendications communes, parfois au sein de coalitions officielles. Dans la plupart des provinces, les travailleuses et travailleurs de la santé ont le droit de grève, sous réserve des lois sur les services essentiels. En Ontario et à l’Île-du-Prince-Édouard, l’arbitrage est automatique en cas d’impasse dans les négociations.
Le Conseil de la santé du SCFP–Î.-P.-É. représente nos membres dans les hôpitaux et les centres de soins de longue durée publics de la province, alors que le SCFP 2523 représente les travailleuses et travailleurs du centre privé Atlantic Baptist Nursing Home. À Terre-Neuve-et-Labrador, les membres du SCFP du secteur de la santé négocient avec la province aux côtés d’autres membres du SCFP travaillant pour le secteur public dans les conseils scolaires, le secteur du logement, les bibliothèques, les maisons de transition et les foyers de groupe. En Alberta, dans le secteur de la santé, chaque section locale négocie sa propre convention collective.
Au Nouveau-Brunswick, le Conseil des syndicats d’hôpitaux du Nouveau-Brunswick (CSHNB-SCFP 1252) négocie une convention collective centrale au nom de 22 sections locales, tandis que le Conseil des syndicats des foyers de soins du Nouveau-Brunswick négocie une convention centrale pour les 51 foyers de soins sans but lucratif qu’il représente. Avec ses 12 unités, la nouvelle section locale 5446 du SCFP représente le personnel syndiqué des centres de soins de longue durée gérés par Shannex.
En Ontario, la plupart des sections locales de milieu hospitalier négocient de façon centralisée par l’entremise du Conseil des syndicats d’hôpitaux de l’Ontario (CSHO) et les gains obtenus servent de référence dans le secteur hospitalier. Les sections locales qui représentent les membres travaillant dans les services de soins de longue durée ou de soins à domicile négocient habituellement leur propre convention collective.
Restructuration du système de santé
Plusieurs gouvernements provinciaux ont apporté des changements majeurs au secteur de la santé ces dernières années, forçant souvent des fusions syndicales et des votes de représentation. En Saskatchewan, les soins de santé ont été regroupés sous une même régie en 2018. Le SCFP est en train d’établir un partenariat officiel de négociation avec le SEIU Ouest afin de négocier une seule convention collective pour le secteur. Au Québec, le nombre de centres locaux de santé et de services sociaux est passé de 182 à 34 en 2017. Cela a entraîné des fusions et des votes de représentation qui ont permis au SCFP d’accueillir plus de 3 000 nouveaux membres.
Au Manitoba, la Loi sur la restructuration des unités de négociation dans le secteur de la santé adoptée en 2017 a réduit à 18 le nombre d’unités de négociation. L’année suivante, après une série de fusions et de votes de représentation, le SCFP est devenu le plus grand syndicat du secteur de la santé de la province, représentant huit unités de négociation et gagnant 9 000 nouveaux membres. En Nouvelle-Écosse, en 2015, neuf régies de la santé ont été fusionnées en une seule, comptant quatre unités de négociation pour représenter les différents groupes professionnels. En 2022, le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a annoncé la fusion prochaine des quatre régies régionales de la santé de la province, même si toutes les données indiquaient qu’une telle centralisation détériorerait la prestation des services de santé.
Principaux enjeux
Les salaires, la santé et la sécurité, ainsi que la charge de travail sont des questions clés au cœur des négociations menées par les sections locales du SCFP dans le milieu de la santé. Les travailleuses et travailleurs souhaitent obtenir des hausses salariales décentes qui suivent le rythme de l’inflation et qui reconnaissent leur valeur. Les sections locales négocient aussi pour obtenir un meilleur soutien en santé mentale pour leurs membres, des protections en cas de pandémie et des mesures pour réduire la charge de travail.
En 2021, au Nouveau-Brunswick, les membres du CSHNB ont participé à une grève générale regroupant plus de 20 000 travailleuses et travailleurs de divers secteurs (éducation, métiers, transport, buanderie, services sociaux, justice, collèges communautaires, sécurité au travail et services correctionnels). Cette grève a permis d’obtenir des gains salariaux importants et l’équité salariale pour le personnel occasionnel qui était auparavant payé moins pour un travail égal.
En 2022, le Conseil des syndicats d’hôpitaux de l’Ontario du SCFP a mobilisé ses membres et le public autour des problèmes de pénurie de personnel et de sécurité d’emploi, et pour réclamer l’abrogation de la Loi visant à mettre en œuvre des mesures de modération concernant la rémunération dans le secteur public de l’Ontario (projet de loi 124), qui limitait les hausses salariales annuelles à un maximum de 1 % de la rémunération totale pendant trois ans.
En 2025, après cinq années difficiles marquées par la pandémie de COVID-19, la hausse du coût de la vie et les pénuries de personnel, le SCFP a remporté une grande victoire en négociant avec Santé Î.-P.-É. une entente qui reconnaît le rôle essentiel de nos membres dans le système de santé. Ce nouveau contrat de trois ans accorde aux membres du SCFP le respect et le soutien mérités par l’entremise d’augmentations salariales substantielles, de meilleures primes de quart et de primes de maintien en poste.
Pour résoudre la crise du personnel en santé, il faut des conventions collectives qui rehaussent les salaires et les effectifs minimaux et les mesures de santé et de sécurité.
Régimes de retraite
Près de 90 % des membres du SCFP qui travaillent en santé ont accès à un régime de retraite agréé. Pour 60 % des membres, il s’agit d’un régime à prestations déterminées. La plupart des membres du SCFP travaillant en santé participent à de grands régimes de retraite multi-employeurs. Certains régimes regroupent parfois des travailleuses et aux travailleurs de la santé et de secteurs connexes, tandis que d’autres s’adressent au personnel des municipalités ou à l’ensemble de la fonction publique. La plupart de ces régimes multi-employeurs sont à prestations déterminées.
CAMPAGNES
Repenser les soins de longue durée
Le SCFP a lancé la campagne nationale Repenser les soins de longue durée afin d’exercer des pressions sur les élu(e)s pour régler les problèmes du secteur. Nous leur demandons notamment d’intégrer les soins de longue durée au système de santé public, de les réglementer en vertu de la Loi canadienne sur la santé et de les financer adéquatement. Nous demandons aussi au gouvernement fédéral d’adopter et de faire appliquer une norme nationale pour les soins de longue durée, notamment pour garantir des effectifs minimaux et éliminer les établissements à but lucratif.
Régime national d’assurance médicaments
Le SCFP et la Coalition canadienne de la santé font campagne pour demander au gouvernement fédéral d’instaurer un régime d’assurance médicaments public et universel. Un tel régime permettrait de réduire le coût des médicaments sur ordonnance et de garantir à chaque personne l’accès aux médicaments dont elle a besoin, au moment où elle en a besoin.
L’assurance médicaments faisait partie de l’entente conclue entre le NPD et les libéraux. La Loi sur l’assurance médicaments a été adoptée en octobre 2024. Le calendrier initial prévoyait la création d’une liste nationale des médicaments essentiels d’ici juin 2025. L’Agence canadienne des médicaments a dressé une liste provisoire de 513 médicaments essentiels et de 6 produits connexes, et mène actuellement des consultations afin d’élaborer la stratégie nationale d’achat en gros de médicaments sur ordonnance et de produits connexes.
L’entente de soutien et de confiance entre le NPD et les libéraux a pris fin en septembre 2024, ouvrant la voie à l’élection de Mark Carney à la tête d’un gouvernement libéral minoritaire. Le Manitoba, la Colombie-Britannique, l’Île-du-Prince-Édouard et le Yukon ont déjà signé des accords bilatéraux sur l’assurance médicaments. Toutefois, dans les autres provinces et territoires, les progrès ont ralenti depuis l’élection du gouvernement minoritaire de Mark Carney : la mobilisation est donc plus essentielle que jamais. Nous devons maintenir et accroître la pression politique pour assurer l’implantation à l’échelle nationale d’un régime d’assurance médicaments universel, public et à payeur unique.
Non à la privatisation de la collecte de plasma
Le SCFP collabore avec des syndicats et des organismes sans but lucratif partout au Canada pour promouvoir l’expansion de la collecte de plasma auprès de donneuses et donneurs non rémunérés. Ces dernières années, plusieurs provinces ont permis à des entreprises à but lucratif de payer des gens pour leur plasma et de le vendre ensuite sur le marché international. Les données internationales et les recommandations de l’enquête Krever au Canada confirment qu’il est préférable que la collecte soit faite auprès de bénévoles. Le SCFP continuera de promouvoir le déploiement des collectes de plasma de la Société canadienne du sang, qui font appel à des donneuses et donneurs non rémunérés et adoptent de bonnes pratiques de dépistage qui assurent la sécurité des personnes qui recevront les dons de plasma et de sang.