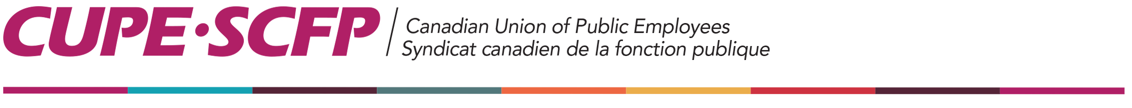SURVOL
Au Canada, le secteur de la production, du transport et de la distribution d’électricité emploie directement 110 000 personnes.
Le SCFP représente plus de 45 000 travailleuses et travailleurs dans le secteur de l’énergie en Alberta, en Ontario, au Manitoba et au Québec. Ces membres exercent des métiers spécialisés, s’occupent de la maintenance, du service à la clientèle, de la comptabilité, du soutien administratif, de la facturation et de la tenue de dossiers, des communications et de la conception de plans, ou encore travaillent dans le sous-secteur de l’énergie atomique, dans des centres d’appels, comme programmeuses et programmeurs-analystes, technologues, monteuses et monteurs de ligne, technicien(ne)s ou commis de bureau.
La majorité de nos membres travaillent pour des entreprises publiques et privées de production, de distribution et de transport de l’électricité.
Les membres du SCFP dans le secteur de l’énergie se répartissent comme suit :
- 600 en Alberta
- 27 000 en Ontario
- 800 au Manitoba
- 17 000 au Québec
ENJEUX
Production d’électricité, changements climatiques et transition équitable
Le Canada est le quatrième plus grand consommateur d’électricité par personne au monde ; mais la majeure partie de cette électricité est produite à partir de sources ne contribuant pas aux changements climatiques. Le pays produit un peu plus de 2 % de l’électricité mondiale, alors que les Canadien(ne)s représentent 0,5 % de la population mondiale. Le Canada est aussi un exportateur net d’électricité à faibles émissions.
On appelle « capacité de production » la quantité d’électricité que les installations électriques peuvent produire. La capacité de production totale en 2023 était de 152 944 gigawatts. La grande majorité de cette production (82,5 %) provient de sources à émissions faibles ou nulles :
- Hydroélectricité : 61,6 %
- Énergie nucléaire : 12,9 %
- Autres sources renouvelables, dont l’énergie éolienne et solaire : 8,0 %
Le reste provient du gaz naturel, du charbon ou du pétrole.
En 2023, les Canadien(ne)s ont consommé 8 485 pétajoules d’énergie, principalement sous forme de gaz naturel (37,6 %) et de produits pétroliers (35,6 %). L’électricité permet de répondre à 23,5 % des besoins énergétiques du Canada.
Le Canada a signé divers traités internationaux l’engageant à réduire sa dépendance aux énergies émettrices de gaz à effet de serre, notamment la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques de 2015. À cela s’ajoute la Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité de 2021, qui vise à atteindre la neutralité en matière d’émission de gaz à effet de serre d’ici 2050.
Le Canada s’est engagé à éliminer la production d’électricité au charbon d’ici 2030, et a réalisé d’importants progrès en vue d’atteindre cette cible. Un tel changement ne peut se faire sans une transition équitable pour les collectivités et les travailleuses et travailleurs des centrales au charbon. Les syndicats luttent pour que les gouvernements investissent dans la reconversion et le redéploiement de la main-d’œuvre touchée.
En mars 2025, le gouvernement du Canada a publié une stratégie en matière d’électricité propre qui mise sur l’électrification des infrastructures, une efficacité énergétique accrue et la production d’électricité à faibles émissions de carbone comme solutions d’avenir. À cet égard, le Règlement sur l’électricité propre finalisé en décembre 2024 limitera les émissions de carbone pour l’électricité produite à partir de combustibles fossiles à compter de 2035, en vue d’avoir un réseau électrique carboneutre d’ici 2050.
Des gouvernements provinciaux, notamment ceux de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick, investissent massivement dans la production d’énergie nucléaire en appuyant la construction de nouvelles centrales et en finançant plus substantiellement la recherche et le développement dans le domaine des petits réacteurs modulaires.
Négociations commerciales et souveraineté énergétique
Depuis l’élection du président Trump, l’exportation d’électricité est devenue un levier dans la guerre commerciale entre le Canada et les États-Unis, dont l’escalade a mis en lumière la vulnérabilité du marché canadien de l’électricité et sa relation d’interdépendance avec le marché américain. La situation a incité le gouvernement fédéral à prioriser les projets visant l’amélioration du réseau de distribution d’électricité d’est en ouest au pays.
En tout, 86 lignes de transport d’énergie relient les deux pays et permettent à l’électricité de circuler librement pour répondre à la demande, sans être affectée par la frontière physique. Si le Canada a toujours été un exportateur net dans cette relation, les deux pays ont bénéficié de leur capacité à équilibrer de manière efficace et rentable l’offre et la demande d’électricité. Toutes les provinces canadiennes qui partagent une frontière terrestre avec les États-Unis ont au moins une interconnexion électrique avec un état américain. Les principales provinces exportatrices sont l’Ontario, la Colombie-Britannique, le Manitoba, le Québec, le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve-et-Labrador. En 2024, le Canada a exporté 35,6 térawattheures (TWh) d’électricité propre vers les États-Unis et en a importé 23,2 TWh. Le Canada fournit environ 85 % de l’électricité importée par les Américains. Ces chiffres doivent toutefois être nuancés, car la quantité d’électricité importée du Canada correspond à seulement 1 % de la consommation totale d’électricité des États-Unis.
Afin de protéger la souveraineté énergétique du Canada face à ce partenaire commercial instable, les gouvernements doivent continuer à investir dans l’amélioration du réseau électrique est-ouest, aider les sociétés publiques de production d’électricité à diversifier leurs sources de revenus et mettre fin à la privatisation du secteur de l’électricité.
Privatisation
Partout au Canada, des subventions publiques versées à des investisseurs privés ont permis de développer la filière de l’énergie éolienne et solaire. Ces investissements ont toutefois fait augmenter la part du privé dans le marché de la production d’électricité.
Des provinces font par ailleurs la promotion de projets solaires, éoliens et marémoteurs privés et coopératifs. Or, cette approche entrave la gestion centralisée de la production d’électricité publique. Elle crée des inefficacités au chapitre de la production et de la distribution d’électricité, ce qui entraîne des augmentations inutiles des coûts et des tarifs.
Selon le SCFP, les emplois dans les énergies vertes devraient relever du secteur public afin d’assurer un avenir énergétique juste et efficace. Pour répondre aux besoins de la population canadienne, il faudrait donc que les gouvernements investissent dans la production, la distribution et le transport d’électricité, assurent la gestion du secteur et le réglementent.
En Ontario, au Québec et au Nouveau-Brunswick, le secteur de l’énergie est de plus en plus menacé par la privatisation en raison de la financiarisation et de la vente d’infrastructures et de services publics. À court terme, c’est toutefois l’accélération de la « corporatisation » et de la sous-traitance des services publics qui menace le plus les travailleuses et travailleurs du secteur.
En Alberta, EPCOR, une entreprise municipale d’Edmonton, a vendu ses actifs au privé pour se retirer complètement de la production énergétique. EPCOR a par contre gardé le contrôle sur la distribution, le transport et les technologies (transmission des données, compteurs, etc.). À l’inverse, ENMAX, une société détenue par la Ville de Calgary, investit dans l’expansion de projets publics de production d’énergie solaire et éolienne.
Au Québec, les sections locales du SCFP font campagne pour préserver le patrimoine collectif que représente la gestion publique de l’électricité, notamment en réclamant que les nouveaux projets éoliens soient sous l’égide d’Hydro-Québec. En juin 2025, le gouvernement de la province a adopté le projet de loi 69 qui, selon les sections locales et des organisations de la société civile, affectera vraisemblablement la souveraineté d’Hydro-Québec. En effet, le projet de loi abolit le droit exclusif de distribution d’électricité d’Hydro-Québec, ce qui permettra à des entreprises privées de vendre de l’électricité. Cette entrée du privé dans ce secteur réduira les revenus du gouvernement qui l’aident normalement à financer les services publics offerts par la province comme les soins de santé, l’éducation et les services éducatifs à la petite enfance.
Au Nouveau-Brunswick, le gouvernement provincial a annoncé qu’il procéderait à un examen de la Société d’Énergie du Nouveau-Brunswick (Énergie NB). Des consultants du secteur privé ont été nommés à la commission d’examen et, selon le gouvernement, toutes les options seront envisagées, y compris la privatisation.
On observe cette tendance à monnayer et commercialiser les actifs publics au profit d’intérêts privés à l’échelle mondiale. Ce « recyclage d’actifs publics » prend diverses formes : contrats de vente, cession-bail, concession, franchise ou gestion d’infrastructures publiques par le privé. La privatisation par l’Ontario de sa société Hydro One est un exemple de ce type de décision à courte vue qui permet à des gouvernements de percevoir des revenus immédiats grâce à la privatisation, mais les prive d’une source de revenus à long terme. L’Ontario a versé l’argent de la vente d’Hydro One dans une fiducie d’actifs servant à financer des projets d’infrastructure et à « subventionner » les tarifs (et bénéfices) des nouvelles entreprises privées créées dans la foulée.
Cette nouvelle menace aux services publics s’ajoute à la privatisation, qui gruge de plus en plus le secteur de l’énergie. Parmi les mécanismes employés pour favoriser la privatisation, on retrouve notamment la décentralisation de la production d’énergie renouvelable par l’entremise d’incitatifs pour des projets privés, le développement privé de nouvelles lignes à courant continu à des fins d’exportation, et la vente de compagnies municipales de distribution.
Au Royaume-Uni et dans une bonne partie de l’Europe, la majorité de la population appuie la renationalisation de services privatisés, dont les services d’électricité. En Australie et dans plusieurs pays d’Afrique, les appels à la renationalisation de l’électricité et d’autres services se multiplient, tout comme les appels au resserrement de la réglementation et à la transition vers la production d’énergie verte.
En Allemagne, en Espagne, au Royaume-Uni et en France, on a enclenché, par l’intermédiaire de coopératives municipales, le rapatriement à l’interne des services municipaux qui avaient été privatisés. Les syndicats australiens ont mené — et gagné — des campagnes très médiatisées contre la privatisation de la capacité de production tout en réclamant de remplacer l’électricité au charbon par des énergies vertes. Plus près de nous, le gouvernement du Manitoba, en présentant sa nouvelle feuille de route pour l’énergie propre en 2023, déclarait fièrement que Manitoba Hydro n’était pas à vendre. L’un des piliers de son plan de croissance économique consiste d’ailleurs à renforcer ses services publics d’énergie en vue d’assurer la sécurité énergétique.
Sur la scène internationale, la privatisation des services publics et la commercialisation des tarifs d’électricité se poursuivent, même si les gens craignent les pannes et les fausses promesses des monopoles du secteur privé. La privatisation a fait exploser les coûts au Royaume-Uni, en Allemagne, en Australie, aux États-Unis, en Inde et au Nigéria.
NÉGOCIATION
Structures de négociation
La réglementation des répercussions environnementales de la production d’électricité (cours d’eau servant à la production hydroélectrique, énergie atomique et transport interprovincial, par exemple) relève du gouvernement fédéral. Tous les autres aspects du secteur sont de compétence provinciale. En Ontario et en Alberta, la production, la distribution et le transport de l’électricité sont confiés à des sociétés régionales. Les structures de négociation suivent le même schéma.
Pour l’aider dans ses négociations, notre seule section locale au Manitoba échange informellement des renseignements avec les sections locales d’Unifor et de la FIOE. Au Québec, le SCFP participe à une coalition syndicale qui mène des négociations centralisées. En Alberta, une section locale du SCFP représente le personnel des services publics municipaux.
L’Ontario compte quant à elle plusieurs unités de négociation dans le domaine de l’électricité. Les conventions collectives d’Hydro One servent souvent de point de comparaison pour les employeurs de la fonction publique provinciale et des sociétés régionales de distribution. Dans cette province, on voit d’un mauvais œil la hausse des employé(e)s temporaires ou contractuel(le)s à Hydro One et à l’Ontario Power Generation. Cette stratégie délibérée permet aux sociétés de contrôler les coûts en offrant des salaires et des avantages sociaux moins généreux.
Rétention, recrutement et formation
Il demeure — et demeurera probablement — difficile de convaincre les gouvernements de penser à moyen et à long terme pour assurer la rétention et le recrutement des travailleuses et travailleurs dans le secteur de l’électricité.
Les changements démographiques ont entraîné de nombreuses nouvelles embauches, mais la pression à la baisse sur les salaires dans le secteur public rend le recrutement difficile.
En matière de santé et de sécurité, il faut former les membres aux plus récentes procédures applicables à leur lieu de travail, que ce soit au bureau, à domicile, sur les lignes de transmission ou sur les sites de production d’énergie thermique, hydraulique ou nucléaire. Les sections locales du SCFP consacrent d’ailleurs des ressources considérables pour assurer la sécurité des travailleuses et travailleurs et mettre en lumière leur rôle important pour alimenter chaque foyer en électricité.
Sécurité d’emploi
Les membres du SCFP dans le secteur de l’énergie subissent des pressions constantes pour abandonner leurs régimes de retraite à prestations déterminées au profit de régimes à prestations cibles ou à cotisations déterminées. Des campagnes soulignant l’importance des avantages sociaux pour la santé et la stabilité de la main-d’œuvre se poursuivent.
La sous-traitance, la hausse des embauches temporaires et l’arrivée de l’intelligence artificielle sont soulevées à toutes les tables de négociation du secteur. Pour maintenir la qualité du travail en situation d’urgence, les conventions collectives du SCFP doivent absolument garantir des effectifs suffisants.
Changements climatiques
Les conventions collectives du SCFP permettent aux membres de prêter assistance partout au Canada et ailleurs dans le monde lors de pannes d’électricité importantes causées par des catastrophes naturelles ou autres.Avec la montée des crises climatiques, les travailleuses et travailleurs de l’électricité du monde entier sont plus essentiels que jamais pour aider les communautés touchées.
Les sections locales du SCFP sont aux premières lignes de la lutte aux changements climatiques. Nos membres discutent régulièrement avec les gouvernements de sujets comme la tarification et la taxation du carbone, l’investissement dans l’atténuation des changements climatiques, la réglementation des nouveaux projets, la hausse de la production pour répondre aux futurs besoins en électricité et les mauvaises politiques énergétiques.
L’avenir de l’énergie verte, c’est l’électricité, à condition que le Canada investisse massivement pour que notre production d’électricité ne soit pas polluante.
CAMPAGNES
Nos sections locales mènent présentement des campagnes sur la santé et la sécurité au travail, la défense des services publics et le financement d’une transition équitable et durable vers une économie faible en carbone. Le SCFP mène aussi des campagnes de syndicalisation et pousse les gouvernements à adopter des plans de relève misant sur la formation et le recrutement.
Le SCFP travaille avec ses alliés pour que l’électricité reste publique partout dans le monde. Nos campagnes internationales portent sur la défense de la propriété publique du secteur énergétique, la lutte contre les changements climatiques et l’élargissement de la coordination internationale des politiques en matière d’énergie.
Le SCFP collabore aussi avec les syndicats du secteur de l’énergie d’autres pays, comme l’Electrical Trades Union en Australie, le syndicat mexicain des travailleuses et travailleurs des services publics et la Confédération générale du travail en France dans le but de soutenir leurs campagnes contre la privatisation et les compressions salariales, et de s’en inspirer. Enfin, nous travaillons avec le comité sectoriel de l’énergie de l’Internationale des services publics, ainsi qu’avec d’autres organismes internationaux comme IndustriALL, Droit à l’énergie – SOS Futur et Syndicats pour la démocratie énergétique.