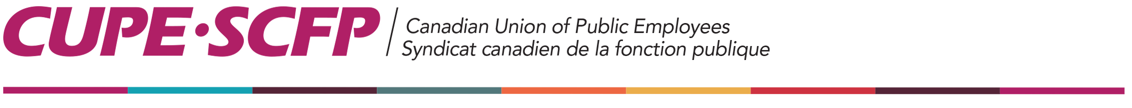Survol
Le président américain Donald Trump a annoncé l’instauration, à compter du 5 mars, de tarifs douaniers de 25 % sur l’ensemble des importations canadiennes, à l’exception des produits énergétiques qui seront assujettis à une taxe de 10 %.
Donald Trump avance plusieurs arguments pour justifier ces droits de douane. Tout d’abord, il prétend que la sécurité des frontières est un problème, notamment en ce qui concerne le fentanyl et l’immigration illégale. Il affirme également que les États-Unis subventionnent le Canada à hauteur de 200 milliards de dollars par année. Cette affirmation repose sur le fait que les États-Unis importent davantage de produits du Canada qu’ils n’en exportent. C’est ce qu’on appelle un déficit commercial. Les économistes ignorent comment Trump a obtenu ce chiffre de 200 milliards de dollars, alors que le déficit commercial entre les États-Unis et le Canada s’élevait à seulement 45 milliards de dollars en 2024. Enfin, Trump souligne que le Canada n’a pas atteint l’objectif de l’OTAN en matière de dépenses militaires.
Contexte
Tarifs douaniers
Un tarif douanier est une taxe perçue par un gouvernement sur les produits importés. Lorsqu’une entreprise importe un produit, elle doit verser au gouvernement un tarif douanier, généralement sous forme d’un pourcentage du coût total du produit. Par exemple, si un pays applique des droits de douane de 25 % sur les céréales, une cargaison d’orge d’une valeur de 10 000 $ serait assujettie à une taxe de 2 500 $. Le coût total de l’importation grimperait ainsi à 12 500 $. L’importateur verserait au producteur d’orge les 10 000 $ habituels, puis s’acquitterait du tarif de 2 500 $ auprès de son gouvernement. Par conséquent, cette mesure touche directement les entreprises qui payeront plus cher les produits importés. Toutefois, comme cette hausse se reflètera dans les prix de vente, elle pénalisera aussi les consommatrices et consommateurs.
Ce type de taxe est généralement utilisé pour protéger les entreprises nationales lorsque les produits importés sont moins chers en raison d’un avantage injuste ou dommageable. Par exemple, une entreprise étrangère pourrait diminuer ses prix de vente si elle bénéficie d’importantes subventions gouvernementales ou si elle est régie par des normes moins strictes en matière de conditions de travail et d’environnement. Des droits de douane judicieusement établis rendent la concurrence plus équitable : devant une hausse du coût des importations, un importateur pourrait décider de s’approvisionner à l’intérieur du pays.
Les répercussions potentielles des tarifs douaniers américains sur le Canada
Étant donné que les tarifs douaniers rendraient les produits canadiens plus coûteux, les exportateurs canadiens pourraient être contraints de baisser leurs prix, de délocaliser leur production aux États-Unis ou de chercher de nouveaux clients à l’international. Trouver de nouveaux acheteurs pourrait s’avérer très difficile, car de nombreuses industries canadiennes et américaines sont étroitement liées, et les entreprises canadiennes se sont largement développées pour répondre aux besoins du marché américain. Le scénario le plus probable est que les entreprises en mesure de transférer leur production aux États-Unis le feront, tandis que les autres devront réduire leur production.
Plus de 75 % des exportations canadiennes sont destinées aux États-Unis. Les exportations canadiennes totalisent environ 50 milliards de dollars chaque mois, dont près de 15 milliards dans le secteur de l’énergie. Des tarifs douaniers généralisés risquent d’entraîner des centaines de milliers de mises à pied et de plonger le Canada dans une récession, qui pourrait être aggravée par le retour de pressions inflationnistes.
Les répercussions potentielles des tarifs d’importation américains sur l’industrie américaine
En raison de la profonde interdépendance des industries canadiennes et américaines, l’ajustement des chaînes d’approvisionnement aux nouveaux tarifs de 25 % constituera un défi majeur pour les États-Unis. Pour compenser l’effet des droits de douane, Trump n’a prévu aucune mesure pour soutenir les secteurs manufacturier et agricole nationaux, ce qui soulève des doutes sur la capacité des États-Unis à remplacer les intrants canadiens. Par conséquent, les prix aux États-Unis risquent d’augmenter, ce qui pourrait amener l’industrie américaine à se ranger du côté du Canada.
L’affirmation de M. Trump selon laquelle « le Canada fabrique 20 % de nos voitures » est trompeuse, car, pour ce qui est de l’assemblage final, le Canada fournit environ 8 % à 9 % des voitures achetées aux États-Unis. Les Services économiques TD estiment qu’il faudrait six nouvelles usines d’assemblage, une augmentation de 75 % de la production américaine et un investissement de plus de 50 milliards de dollars pour remplacer l’assemblage automobile canadien, sans compter la fabrication des pièces. De même, les usines de raffinage aux États-Unis, construites pour traiter le pétrole brut lourd canadien, auraient du mal à délaisser cette matière première. Même un tarif douanier de 10 % sur cette matière première augmenterait considérablement les prix à la pompe.
Les arguments de Trump et la réponse du Canada
Dans l’Énoncé économique de l’automne, publié en décembre, Ottawa a alloué 1,3 milliard de dollars pour mettre fin au trafic de fentanyl et améliorer la surveillance à la frontière canado-américaine, en réponse aux préoccupations de Trump. Cependant, le Canada n’est pas un vecteur problématique en ce qui concerne l’immigration illégale ou le trafic de fentanyl. Les douanes américaines font état de saisies de moins de 20 kg de fentanyl à la frontière canadienne, contre plus de 9 000 kg à la frontière mexicaine. De plus, environ 1 % seulement des personnes interceptées qui tentent d’entrer illégalement aux États-Unis proviennent du Canada. En outre, le déficit commercial du Canada avec les États-Unis, qui ne représente que 4 % du déficit commercial total des États-Unis, provient principalement du secteur de l’énergie et des pièces automobiles. Cela reflète davantage un pouvoir d’achat plus élevé aux États-Unis qu’une forme de subvention. En matière de défense, le Canada prévoit d’augmenter ses dépenses de 1,37 % à 2 % du PIB, soit environ 20 milliards de dollars de plus par an pour l’achat de nouveaux équipements.
Réponse aux tarifs douaniers américains
Au cours du premier mandat de Trump, les droits de douane imposés par les États-Unis sur l’acier et l’aluminium canadiens ont poussé le Canada à répondre par des mesures équivalentes, en taxant notamment des produits américains comme le jus d’orange de Floride et le bourbon du Kentucky. Le Canada est parvenu à négocier, au bout d’une année, une exemption de ce tarif douanier grâce aux efforts coordonnés des gens d’affaires et des milieux politiques canadiens et américains. Trump étant désormais moins préoccupé par sa réélection, les tarifs ciblés pourraient s’avérer moins efficaces. Néanmoins, le Canada a réaffirmé son engagement à riposter dollar pour dollar. Parmi les options extrêmes figurent la restriction de l’approvisionnement en énergie et en minéraux essentiels — une mesure appuyée par toutes les provinces sauf l’Alberta — ainsi que l’imposition de droits d’exportation sur certains produits. Ces tactiques ciblent des points névralgiques, le Canada fournissant environ 60 % du pétrole importé par les États-Unis et assurant l’approvisionnement en électricité de plusieurs États américains à partir de la Colombie-Britannique, de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick.
Réponse en soutien à l’économie canadienne
Le gouvernement fédéral pourrait adopter des mesures d’urgence pour aider les entreprises et la main-d’œuvre touchées. Elles pourraient inclure des prêts à faible taux d’intérêt aux entreprises, une aide pour trouver de nouveaux acheteurs sur le marché international et un élargissement de l’assurance-emploi. Emploi et Développement social Canada (EDSC) examine les mesures prises par le passé pour lutter contre les ralentissements économiques et les différends commerciaux. Le Parlement ne siège pas, mais le gouvernement fédéral peut assouplir les exigences du programme de Travail partagé et éliminer la période d’attente d’une semaine de l’assurance-emploi sans obtenir le consentement du Parlement. EDSC pourrait également déployer des programmes ciblés ou réactiver des mesures d’assurance-emploi mises en place durant la COVID-19, lesquelles ne nécessitent que l’approbation du Cabinet. Parallèlement, des économistes de droite et des groupes d’intérêt font pression pour des baisses d’impôts et une déréglementation pour dynamiser le commerce interprovincial et préserver la compétitivité de l’économie canadienne.
Réponse du SCFP
En tant que syndicat du secteur public, il reste incertain si, et dans quelle mesure, ces tarifs auront des conséquences sur les emplois des membres du SCFP. Nous pourrions voir une incidence dans le secteur de l’énergie ou au Port de Montréal. Plus les droits de douane resteraient en vigueur longtemps, plus le risque de pressions budgétaires s’intensifierait à tous les ordres de gouvernement, avec d’éventuelles répercussions sur les travailleuses et travailleurs du secteur public.
Le SCFP collabore étroitement avec d’autres syndicats canadiens sur les questions commerciales par l’entremise du Congrès du travail du Canada et du Réseau pour le commerce juste. Nous nous tiendrons aux côtés de nos allié(e)s du mouvement syndical pour protéger les emplois et les moyens de subsistance des Canadien(ne)s, et nous résisterons aux tentatives de la droite d’instrumentaliser cette crise pour promouvoir son agenda de réduction des services publics.