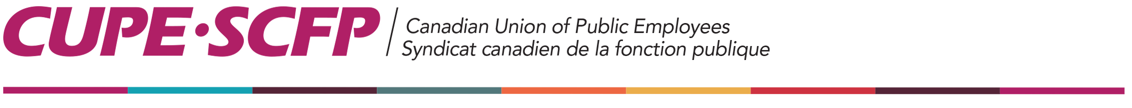SURVOL
La quasi-totalité des membres du secteur des communications du SCFP travaillent pour des employeurs du secteur privé de compétence fédérale qui est réglementé par le CRTC. Le secteur compte approximativement 6 100 membres, dont l’immense majorité est au Québec (plus de 98 %).
On peut regrouper les sections locales du secteur des communications en trois sous-secteurs :
- Celui des télécommunications, le plus grand d’entre eux avec plus de 82 % des membres, inclut la câblodistribution, la téléphonie et les fournisseurs de service Internet (Cogeco, Telus, Vidéotron, Rogers, Acronym Solutions, Bruce Telecom, Cochrane Telecom Services).
- La radio, la télévision et la presse écrite regroupent quelque 14 % des membres dans des médias de premier plan (Groupe TVA, Journal de Québec, Global, RNC Media, Cogeco Média, Bell Média, CTV, Rogers, Vista Radio).
- La cinématographie et la postproduction (Office national du film, SETTE, Difuze) comptent environ 4 % des membres. Il s’agit du seul sous-secteur à représenter des travailleuses et travailleurs du secteur public (ONF).
Parmi les principaux types d’emplois du secteur des communications du SCFP, on retrouve : des technicien(ne)s et spécialistes des technologies de l’information, des préposé(e)s de centres d’appels, du personnel de bureau, des journalistes, des techniciennes et techniciens créatifs (caméra, aiguillage, montage, intégration et mixage sonore), des réalisatrices et réalisateurs et des représentant(e)s en publicité.
ENJEUX
Changements technologiques, sous-traitance et réglementation
Le secteur des communications est en transformation constante en raison de son recours important à la technologie qui évolue sans cesse. Ce phénomène entraîne des modifications dans les habitudes de consommation, dans les pratiques commerciales des entreprises, ainsi que dans les lois et règlements qui les encadrent. Des changements importants à l’organisation du travail, des délocalisations et des pertes d’emplois en découlent malheureusement souvent.
À la SETTE et chez TVA, nos membres qui effectuent du sous-titrage ont été frappés de plein fouet par l’utilisation de systèmes d’intelligence artificielle (IA) pour effectuer leur travail. Une cinquantaine de personnes ont perdu leur emploi en 2023-2024 pour cette raison.
Dans les télécommunications, les employeurs préfèrent notamment automatiser des tâches (grâce à de nouvelles technologies comme l’IA) et avoir recours à la sous-traitance ou à des contrats « clé en main », plutôt que de former leurs employé(e)s de longue date. Les ratios de sous-traitance permis par les conventions collectives sont en hausse depuis quelques années. Les postes qui se libèrent ne sont donc pas toujours affichés. Le sous-secteur des télécommunications voit donc le nombre de ses membres décliner depuis la pandémie.
À cela s’ajoutent des incertitudes quant à l’avenir de l’industrie. Une récente décision du CRTC a notamment le potentiel de causer une diminution des investissements dans les réseaux de télécommunications. Cela pourrait avoir un impact sur la concurrence et l’emploi, tout comme la perte de clients en câblodistribution, une technologie en perte de vitesse.
Environnement légal en transformation
Le gouvernement fédéral a modernisé la Loi sur la radiodiffusion (Loi), en 2023, pour y inclure les entreprises en ligne, comme Netflix et Disney +. L’idée était de rétablir l’équité en imposant à ces dernières des conditions d’exploitation visant à soutenir la production d’émissions canadiennes diffusées à la radio, à la télé et en ligne. Une première politique réglementaire du CRTC, en 2024, a mené à l’imposition de contributions de base aux géants du Web. Toutefois, cette décision est contestée en Cour d’appel fédérale, ce qui bloque le versement du soutien prévu aux entreprises canadiennes.
Le SCFP s’implique dans la révision réglementaire menée par le CRTC à la suite de la modernisation de la Loi, afin de protéger au mieux les emplois dans les médias électroniques et chez les câblodistributeurs. La réglementation est cependant tellement longue à mettre en place que l’avenir de nos médias est loin d’être garanti. La radio et la télévision continuent en effet à voir leurs revenus publicitaires et d’abonnements chuter.
Pour faire face à la diminution des revenus publicitaires de ses stations de télévisions locales, Québecor a utilisé une disposition réglementaire lui permettant de fermer son canal communautaire MAtv, à Montréal, pour en transférer le budget à la production de nouvelles chez TVA. Bien qu’ayant permis de maintenir des emplois chez TVA, cette source de financement a toutefois causé de nombreux licenciements chez MAtv. Une belle illustration de l’adage : Déshabiller Pierre pour habiller Paul.
La mise en œuvre de la Loi sur les nouvelles en ligne – qui impose aux géants du Web de partager une partie de leurs profits avec les médias dont ils exploitent les nouvelles – commence par ailleurs à porter fruit. Google s’est engagé à verser 100 millions de dollars par année aux médias d’information canadiens pendant cinq ans. Une partie du montant pour 2024 a commencé à être distribué, mais ici encore, la lenteur du processus désavantage les employeurs du secteur des communications. De plus, Facebook a choisi d’empêcher les nouvelles de circuler sur sa plateforme pour éviter d’avoir à payer, ce qui a l’effet pervers de laisser davantage de place à la désinformation.
Structures corporatives et accréditations
Les employeurs du secteur sont devenus les champions des structures corporatives créatives visant à contourner les accréditations syndicales.
Chez Telus, les travailleuses et les travailleurs syndiqués sont de plus en plus isolés dans diverses filiales où des non-syndiqués effectuent le même travail. Plus de 200 postes seraient syndicables.
Québecor (Groupe TVA, Vidéotron, Journal de Québec) a aussi déplacé ses syndiqué(e)s dans des unités non-syndiquées au cours des dernières années, mais en exigeant qu’ils et elles renoncent à leur convention collective pour conserver leur emploi. De plus, depuis le licenciement de plus de 500 membres annoncé en novembre 2023, TVA a déménagé ses opérations dans les locaux du Journal de Montréal et le Journal de Québec s’apprête à joindre les équipes de TVA à Québec.
Ces mouvements de personnel créent des problèmes d’espace, ainsi que des enjeux potentiels sur le plan des accréditations syndicales et de la diversité de l’information.
Sous-financement de l’Office national du film
La stagnation du budget de l’Office national du film entraîne une baisse importante de son pouvoir d’achat en raison de l’inflation élevée des dernières années. Cela menace les emplois de nos membres chez le producteur public.
NÉGOCIATIONS
Salaires, conditions de travail et pertes d’emplois
Pour les travailleuses et travailleurs syndiqués du secteur, les salaires sont plutôt bons, mais la rétention de talents se fait plus difficile dans certains corps de métier. C’est notamment le cas en informatique et dans des postes de gestion intermédiaires où un écart continue de se creuser entre les salaires de nos membres et ceux offerts par d’autres entreprises. Cela entraîne de nombreuses démissions dans nos rangs, malgré des avantages sociaux supérieurs.
Avec la montée de l’inflation, la plupart des sections locales du sous-secteur des télécommunications ont cependant réussi à aller chercher des augmentations salariales plus substantielles que par le passé allant jusqu’à 5,5 % par année. Cela contraste de façon importante avec la situation du côté des médias. Les employeurs faisant face à des baisses de revenus, les augmentations négociées oscillent entre 1 % et 3 %.
Par ailleurs, certains employeurs commencent à insister pour mettre fin au télétravail, du moins partiellement, ce qui ne plaît pas à tous les membres, crée des divisions et complique les négociations.
Sous-traitance et travail précaire
Le secteur des communications étant presque entièrement privé, la recherche du profit est prédominante. On constate depuis quelques années l’usage plus fréquent de sous-traitants au Canada et à l’étranger, où les salaires et les conditions de travail sont plus faibles, de même que le recours à des personnes occupant des postes temporaires ou à des pigistes.
Malgré ce contexte, nos membres chez Cogeco ont réussi à mettre un terme à l’embauche de personnel temporaire lors de leur dernière négociation. Ainsi, tous les membres de la section locale travaillent maintenant à temps plein, à l’exclusion de celles et ceux ayant choisi d’occuper un poste à temps partiel.
Formation
Dans le contexte des changements technologiques rapides et de l’adoption de l’IA, la formation et le perfectionnement des travailleuses et travailleurs du secteur prennent une importance grandissante.
Alors que certains employeurs maintiennent des budgets de formation, d’autres insistent pour que les travailleuses et travailleurs assument la responsabilité de leur formation – en partie du moins – pour rester à jour dans leur emploi.
Régimes de retraite
La presque totalité des milieux de travail du secteur offrent des régimes de retraite. On y retrouve un mélange de régimes à contributions déterminées, de régimes à prestations déterminées et de RÉER collectifs. Dans le cas des entreprises privées qui offrent encore un régime à prestations déterminées, les employeurs veulent cependant réduire les bénéfices pour diminuer leurs propres risques.
CAMPAGNES
Le secteur s’est impliqué dans la campagne qui a mené à l’adoption, par la Chambre des communes, d’une première loi anti-travailleurs de remplacement, entrée en vigueur en juin 2025.
Il commence également à s’impliquer dans une campagne intersyndicale nationale visant à juguler la perte d’emplois dans le secteur des télécommunications.