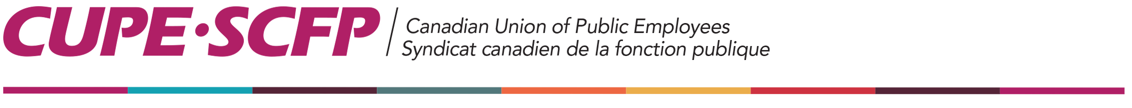Parmi les États voyous de ce monde, la Birmanie occupe une place à part, tant « il faut voir ce qu’il s’y passe pour le croire », comme le dit Bono dans une des chansons de U2. Dirigée depuis 47 ans par une dictature militaire brutale qui bafoue les droits de la personne de toutes les manières imaginables, le pays aujourd’hui connu sous le nom de Myanmar est passé d’un statut de pays prospère – le « bol de riz de l’Asie » – à un endroit où 39 millions de personnes, soit la majorité de la population, vivent sous le seuil de la pauvreté.
Malgré les milliards d’aide reçus de la Chine, de l’Inde et d’autres États asiatiques faisant partie de sa sphère d’influence, la junte birmane dépense moins d’un dollar par personne en services d’éducation et de santé. En Birmanie de l’Est, un enfant sur cinq meurt avant l›âge de cinq ans. Amnistie Internationale et l’Organisation Internationale du Travail ont condamné le pays pour son recours au travail des enfants, pays qui détient par ailleurs le record mondial du taux le plus élevé de recrutement d’enfants-soldats.
Au cours des deux dernières décennies, plus d’un million de Birmans ont reçu le statut de « personnes déplacées », s’étant vues contraintes par des soldats de l’armée birmane de quitter leur foyer ou leur village dans le feu des rébellions ethniques et de vivre désormais sans abri dans la jungle ou les campagnes environnantes. Un grand nombre d’autres Birmans ont été carrément chassés du pays et poussés dans des camps de réfugiés situés près de la frontière birmano-thaïlandaise, lorsqu’ils ne sont pas exploités comme travailleurs migrants en Thaïlande, où ils gagnent aussi peu que 2 $ par jour.
Quand la réalité s’impose
Ce mois-ci, les membres et le personnel du SCFP ont eu un aperçu de la vie en Birmanie grâce à la visite d’un défenseur des droits des Birmans, issu du peuple karen, parrainé par le Syndicat et CUSO-VSO, un organisme de développement international à but non lucratif qui fait appel à des coopérants-volontaires.
Saw Kwehsay coordonne le comité de planification et d’information de même que la campagne de « Peaceway Foundation – Burma Issues », qui est une organisation non gouvernementale établie à Bangkok et qui offre de la formation sur les droits de la personne aux réfugiés birmans hors frontières, comme à ceux qui tentent d’aider à l’intérieur du pays. Le Fonds justice mondiale du SCFP subventionne un des projets de M. Kwehsay à la frontière birmano-thaïlandaise.
Le militant karen est arrivé au Canada en octobre et a assisté au congrès national du SCFP à Montréal, où il a rencontré d’autres militants membres et employés du Syndicat, à qui il a présenté un compte rendu du projet. La semaine dernière, après un passage à Ottawa où il s’est entretenu avec des membres de la communauté birmane, il s’est rendu en Colombie-Britannique.
De réfugié de la jungle à militant international
Partout où il passe, M. Kwehsay refait le récit de ses dures années en Birmanie. En 1976, sa famille a été forcée de s’enfuir sous la menace de soldats armés qui ont littéralement anéanti son village. Son père a été tué par l’armée trois mois avant la naissance de sa sœur cadette. La famille a passé les huit années suivantes sans domicile fixe, privée d’éducation et de soins de santé – parfois aussi de nourriture.
« J’ai pensé pendant des années que personne d’autre que nous vivait dans la jungle, se rappelle-t-il. Nous mangions ce que nous y trouvions pour survivre. »
La vie était si dure que sa mère a envisagé de se suicider et de donner la mort à ses enfants. Après avoir franchi la frontière birmano-thaïlandaise en 1984, M. Kwehsay a passé dix ans dans le camp de réfugiés Kway K’Lok, près de Mae Sot. À son départ du camp en 1994, il a entrepris de se consacrer à la défense des droits des Birmans.
« Les nombreuses fois que je suis retourné dans ma région entre 1990 et 1993 pour rendre visite à ma mère, j’ai constaté que la situation ne s›était pas améliorée. Malgré des décennies de lutte armée sous la direction de l’Union nationale Karen et d’autres armées rebelles, rien n’avait changé. J’en suis venu à croire que la solution au conflit birman devait être pacifique et non violente. »
M. Kwehsay a commencé à recueillir de l’information sur les droits de la personne dans son propre village, en photographiant l’endroit où sa maison avait été détruite et en recueillant les témoignages de gens qui avaient connu ou côtoyé des soldats de l’armée birmane. De passage à son ancien camp de réfugiés, il montra ses photos à ceux qui s’y trouvaient et en envoya à des amis émigrés aux États-Unis.
« Pour un “homme de la jungle” qui a vu sa première école à l’âge de huit ans, j’étais étonné de découvrir que je pouvais utiliser de l’information pour tisser des liens à l’échelle internationale », raconte d’une voix posée le militant de 36 ans, que le rude passé a fait vieillir prématurément.
Des reportages crédibles grâce au récit de témoins locaux
Lorsqu’il parcourait les villages birmans, M. Kwehsay donnait de la formation aux villageois sur les droits de la personne. « Je les ai aidés à se familiariser avec les droits de la personne, la charte des Nations Unies et les façons de monter un dossier sur les violations de droits dans leur région. Je leur ai donné des trucs comme noter le numéro de bataillon des soldats de passage au village. »
Au début, M. Kwehsay s’est buté à des villageois extrêmement méfiants à l’idée de se faire interroger.
« Pendant des années, de nombreux journalistes occidentaux sont venus enquêter sur la situation, mais ils ne sont jamais revenus et les gens n’ont jamais su ce qui était advenu de l’information qu’ils leur avaient donnée, raconte-t-il. Alors j’ai dû trouver des villageois qui me feraient suffisamment confiance pour me raconter leur histoire.
Leurs témoignages, que j’ai par la suite diffusés auprès de journalistes et d’étudiants sensibles à la cause birmane, ont donné matière à des analyses et servi de sources d’information, tout en jouant un rôle préventif, car lorsque vous avez des renseignements véridiques, vous pouvez informer les villageois à l’avance au sujet de possibles projets de construction de barrages ou de ponts dans une région donnée, où l’armée mettra en place des forces de sécurité. »
Un projet vidéo subventionné par le SCFP accroît l’autonomie des villageois
En 2003, des organisations réalisant le même type de travail pour faire respecter les droits de la personne dans la région frontalière ont décidé de constituer un réseau pour mettre en commun leurs ressources et mieux documenter les droits des Birmans (« Network for Human Rights Documentation – Burma », connu sous le nom de ND–Burma). L’initiative avait pour but de partager les compétences complémentaires de chaque organisation et de faire connaître les résultats des projets menés par chacune. Au cours de ce processus, le groupe Burma Issues a pris le nom de « Peaceway Foundation », en Thaïlande (supprimant la référence à la Birmanie pour ne pas froisser le gouvernement de la Thaïlande) et s’est donné comme mission de produire des documentaires vidéo. Grâce à un appui financier du SCFP, un coopérant-volontaire a ainsi pris part à la réalisation de diverses vidéos de formation sur les droits de la personne pour Burma Issues.
« Si vous êtes un décideur haut placé, vous n’avez sans doute pas le temps de lire un gros rapport, alors qu’après quelques minutes de visionnement d’une vidéo vous voyez les gens, leurs visages – c’est beaucoup plus efficace et intéressant qu’un gros rapport parce que vous pouvez partager directement l’expérience des Birmans de l’intérieur, une réalité très difficile à imaginer », explique M. Kwehsay pour décrire l’impact des vidéos notamment sur les politiciens occidentaux approchés pour soutenir la cause de la démocratie en Birmanie.
M. Kwehsay ajoute que les vidéos sont également distribuées en Birmanie où elles reçoivent un bon accueil, spécialement des villageois qui ont fait preuve de beaucoup de courage en acceptant d›être interviewés devant la caméra.
« Les villageois gagnent beaucoup d’assurance en voyant à quoi peut servir l’information fournie, ajoute-t-il. Ils se sentent partie prenante d’un processus aux côté d’autres personnes maltraitées comme eux, dont les témoignages ont permis, tout comme les leurs, de faire connaître leur histoire. »
Au forum Justice mondiale du dernier congrès national du SCFP, M. Kwehsay a fait état de la situation récente en Birmanie en déplorant que les journalistes occidentaux soient incapables de rapporter les exactions que ne cesse de perpétrer la junte contre les civils.
« C’est pourquoi l’appui du SCFP est si important, dit-il. En Birmanie, travailler à la protection des droits de la personne est un délit passible d’arrestation. Les gens n’arrivent pas pour la plupart à communiquer facilement par téléphone ou par courriel. Cela coûte cher. C’est donc plus facile de former des gens à la frontière et de bâtir des réseaux d’appui qui ont une résonance internationale. »
Besoin d’appui additionnel
Même si la situation politique ne s’améliore pas en Birmanie, M. Kwehsay rappelle que si rien n’était fait, les choses empireraient pour les gens là-bas.
Les membres du SCFP peuvent aider en se renseignant sur la situation locale en Birmanie, en en parlant dans leur entourage et en faisant pression sur leur député pour qu’il obtienne du gouvernement Harper un engagement à maintenir l’aide humanitaire en Birmanie et à soutenir une résolution obligatoire sur la Birmanie aux Nations Unies.
Au cours des dernières semaines, les Amis canadiens de la Birmanie (CFOB) ont distribué des cartes postales adressées au premier ministre en appui à ces deux causes. Grâce à l’appui du SCFP, ce groupe a distribué ces cartes postales à Toronto durant les concerts de U2, reconnu pour son appui à la cause birmane, et prévoit en distribuer aux prochains concerts de U2 à Vancouver. On peut se procurer ces cartes postales au bureau national et aux bureaux régionaux du Syndicat.